Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
2 participants
Page 1 sur 1
 Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Commission des Finances, de l’économie générale et du Plan
Mercredi 9 avril 2008
Séance de 9 heures 30
Compte rendu n° 71
Présidence de M. Didier Migaud, Président
– Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française, sur la crise financière et la régulation des systèmes bancaires
Le Président Didier Migaud : Nous accueillons aujourd’hui M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française, la FBF, et président-directeur général de la Société générale.
La commission des Finances se préoccupe depuis plusieurs mois du développement d’une crise financière internationale dont les effets sur l’économie réelle sont désormais avérés. Cette crise a commencé par une crise du crédit immobilier qui a conduit à une crise bancaire. À ce sujet, nous souhaitons entendre le représentant des banques françaises que vous êtes.
Il se trouve que, dans le même temps, la banque que vous présidez a connu de sérieuses turbulences dues aux prises de position excessives d’un de vos traders, dont les engagements avaient atteint 50 milliards d’euros lorsqu’ils ont été découverts, en janvier dernier. Naturellement, nous nous interrogeons sur la pertinence des contrôles internes à la Société générale mais aussi sur celle des contrôles externes assurés par les régulateurs français ; cette question vaut aussi pour les autres banques puisque certains de vos confrères n’ont pas exclu qu’elles pourraient connaître les mêmes déboires.
La crise des subprimes a eu les effets que l’on sait, en raison d’abord du développement de produits complexes issus d’une titrisation qui s’est emballée ces dernières années, ensuite d’une notation inadéquate, voire défaillante, de produits amalgamant des créances de qualité très inégale et dont le risque n’avait pas fait l’objet d’une identification réelle, enfin d’une diffusion de ces produits dans des marchés interconnectés.
La commission des Finances a entendu à ce sujet, le 2 octobre dernier, les superviseurs des marchés bancaire et financier français, Christian Noyer et Michel Prada, le directeur de la Banque de financement et d’investissement du groupe Société générale, Jean-Pierre Mustier, le directeur général de l’agence de notation Fitch Ratings, Richard Hunter, ainsi que les économistes Michel Aglietta et Henri Bourguinat.
Il nous a semblé, à l’époque, entendre deux économistes inquiets mais quatre acteurs du système financier et bancaire plutôt sereins, même s’ils admettaient que l’économie internationale était relativement incertaine. Selon ces derniers, le problème était plutôt bien circonscrit aux banques américaines, les banques européennes étaient peu affectées par la crise des subprimes, il convenait de relativiser la crise et, par ailleurs, les conditions n’étaient pas réunies pour laisser prévoir un retournement de la croissance.
Aujourd’hui, il apparaît que les banques européennes ne sont pas épargnées. Les pertes déjà enregistrées par les banques françaises et les provisions qu’elles ont passées – de 800 millions d’euros pour la Caisse d’épargne à 4 milliards pour le Crédit agricole – sont moindres, bien moindres que celles des banques les plus exposées, comme UBS, Merril Lynch, Citigroup, HSBC ou Morgan Stanley, mais elles sont élevées et suscitent des interrogations sur le fonctionnement des marchés et des banques.
Au-delà de la sphère financière, c’est l’économie réelle qui est touchée : aux États-Unis, l’ensemble du marché du crédit est affecté par la crise, les rehausseurs de crédit sont sur la sellette, en 2007 les saisies immobilières ont dépassé le million, l’économie est en fort ralentissement, voire en récession. La crise de confiance qui s’est exprimée au travers d’une crise de liquidité interbancaire n’est pas résolue.
La prévention des crises de cette nature devient par conséquent une priorité.
Nous avons reçu récemment Alexandre Lamfalussy, ancien directeur de la Banque des règlements internationaux, la BRI, et du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, qui a souligné le contexte d’asymétrie de l’information dans lequel de nouveaux instruments financiers, mal évalués, avaient été développés et distribués à travers le monde. L’une de nos interrogations porte d’ailleurs sur l’attitude des banques, qui n’ont certes pas, ou pas toutes, distribué des crédits à haut risque mais qui ont acquis des produits en partie composés de ces créances. N’avaient-elles aucune idée du risque qu’ils présentaient ? Faisaient-elles une confiance aveugle aux notations des agences ?
Nous nous sommes interrogés sur les systèmes d’alerte à mettre en place au niveau des marchés et aussi sur l’évolution de l’activité des banques. Étant donné l’ampleur des enjeux financiers, les risques nouveaux sur les activités de marché – risques de crédit, de fraude, de liquidité – et la diversité des activités couvertes par les établissements bancaires, ces derniers devraient-ils infléchir leurs stratégies ? Dans quel sens ?
Vous voudrez bien, dans un premier temps, faire le point, autant qu’il est possible, sur l’affaire de la surexposition de la Société générale par un de ses traders. Nous souhaiterions par exemple que vous nous décriviez les relations existant entre les traders et leur hiérarchie, car nous avons tous été stupéfaits qu’une seule personne puisse mener de telles opérations sur une assez longue période, et que vous nous expliquiez comment sont traitées les alertes venant des marchés. Nous aimerions également recueillir votre analyse de la crise de confiance affectant les marchés bancaire et financier. Puis les membres de notre commission ne manqueront pas de vous poser des questions.
M. Daniel Bouton : Je suis accompagné par Ariane Obolensky, directrice générale de la FBF, qui pourra également répondre à vos questions.
Il est excellent pour la démocratie que votre Commission ait commencé à travailler dès le mois d’octobre sur ce sujet, réservé alors à la planète finance mais qui préoccupe aujourd’hui légitimement tout le monde.
Les entreprises et les banques n’œuvrent pas de manière disjointe. La banque est une industrie et même l’une des principales de France. Nous employons 400 000 salariés et nous recrutons annuellement 40 000 collaborateurs. Nous finançons l’économie à travers 1 400 milliards d’euros de crédits et 1 000 milliards de dépôts. Notre activité représente environ 3 % du PIB.
Nous sommes très divers : la FBF regroupe des établissements coopératifs, mutualistes, mixtes et purement privés, dont deux des plus grandes banques cotées, BNP Paribas et la Société générale.
Nos métiers sont extrêmement variés. L’agence bancaire classique, qui contribue au financement du boulanger ou du serrurier, est bien connue. La chaîne de métiers permettant de financer l’ensemble de l’économie l’est moins. La finance, comme le monde, s’est progressivement ouverte et globalisée. Il y a trente ans, une grande entreprise se finançait essentiellement par des syndicats bancaires. Avec la marchéisation, entamée en France sous l’égide de Bérégovoy, les grandes entreprises se financent directement sur les marchés, ce qui rend les ressources financières moins chères en supprimant la marge d’intermédiation bancaire. Du côté de la ressource, les investisseurs institutionnels – notamment l’État ou le Fonds de réserve pour les retraites – interviennent directement sur les marchés. Aux États-Unis comme en Europe, les banquiers ne sont plus seulement des prêteurs ; ils ont accompagné le mouvement de marchéisation en développant de nouvelles activités sophistiquées car une banque qui n’évolue pas est condamnée à périr. Grâce au talent de ses banquiers, dans les deux grands établissements cotés mais aussi au Crédit agricole à travers sa filiale Calyon ou à la Banque populaire à travers sa filiale Natixis, la France est l’un des seuls pays au monde à disposer d’une vraie industrie de la finance sophistiquée.
Je vais vous décrire deux métiers.
Le premier est celui de la titrisation. Au milieu des années cinquante, les quelques centaines de milliers de ménages français susceptibles d’acheter une voiture n’ont pas accès au crédit. La Compagnie bancaire lance alors le premier crédit à la consommation. Mais, puisque l’État pompe la totalité de l’épargne française, La Compagnie bancaire doit se financer court et transformer ces ressources en créances à quatre ans. Un peu plus tard, la titrisation est inventée : au lieu de transformer l’épargne, l’établissement bancaire vend directement aux investisseurs du marché financier les créances à quatre ans qu’il détient sur les particuliers en les regroupant en paquets. Aujourd’hui, en Europe, la titrisation représente 460 milliards d’euros. Ce volume subit toutefois une baisse considérable depuis le début 2008 ; le crédit, moteur du financement de l’économie, manque par conséquent d’une ressource considérable.
Le second métier dont je vais vous entretenir a été rendu célèbre pas la position dissimulée du fraudeur : ce sont les activités pour compte propre. Contrairement aux fonds spéculatifs, les banques ne prennent jamais de positions directionnelles importantes sur la hausse du dollar ou la baisse du pétrole par exemple. Nous divisons le risque pour le maîtriser. La découverte d’une position dissimulée peut donc poser des problèmes considérables. Je signale au passage que la fraude a toujours existé dans l’histoire des banques et qu’elle existera toujours. La part des activités pour compte propre des banques françaises est faible, voire très faible.
Le monde de l’économie réelle et le monde financier ne sont pas séparés. La financiarisation de l’économie permet de financer la croissance ; sans elle, le monde occidental n’aurait pas connu son formidable développement. Les banques françaises figurant parmi les plus performantes et les plus reconnues dans certains métiers, l’économie française est l’une des principales bénéficiaires de la titrisation.
Cela dit, la crise née aux États-Unis est très grave.
La crise originelle a été bien analysée dans vos auditions précédentes. Dans certains États américains, des crédits immobiliers peuvent être distribués par des courtiers, c’est-à-dire des intermédiaires échappant aux régulations et contrôles applicables au secteur bancaire. Pour leur part, les banques françaises sont favorables à un contrôle de la distribution du crédit et de la circulation de la monnaie par des régulateurs puissants. Depuis trois ou quatre ans, les courtiers américains n’examinaient plus les capacités de remboursement de l’emprunteur mais uniquement la valeur du gage, c’est-à-dire de la maison. Le niveau de protection du consommateur est extrêmement variable d’un État à l’autre, tout comme en Europe, du reste. Toutefois, chez nous, la loi bancaire interdit à quiconque de prêter de l’argent s’il ne possède pas le statut de banque.
Le deuxième facteur de la crise est la dissémination du risque. Nous sommes partisans de la titrisation. Une crise bancaire classique se transforme en crise économique générale parce qu’une banque saute et propage la crise dans la région, le pays, voire le monde. La titrisation permet de distribuer et de disséminer le risque. Mais cela repose, pour bien fonctionner, sur trois conditions qui n’étaient pas totalement réunies au moment de l’explosion : les produits doivent être visibles ; les engagements des émetteurs doivent être clairs ; les investisseurs doivent être capables d’apprécier à quoi correspondent les créances et ne pas se référer uniquement au rating des agences indépendantes.
Troisièmement, les banques ont des engagements résiduels dans certains produits titrisés sophistiqués. Selon leur politique propre et les règles de régulation nationales, elles peuvent laisser tomber un produit – ce sont alors les investisseurs qui assument la totalité de la perte – ou au contraire prendre un engagement de liquidité, voire intégrer cette participation dans leur bilan. Or certains contrats concernant de tels véhicules contenaient des imperfections et n’étaient pas parfaitement clairs.
Sur ces trois chapitres, tout n’était donc pas parfaitement clair ; la crise financière part de là. Au-delà de la crise des subprimes, qui mettra à la rue 2,2 millions de ménages américains, le manque de clarté entraînera une méfiance généralisée vis-à-vis des marchés financiers et même vis-à-vis des bilans des banques américaines.
Nul ne sait encore combien cette crise coûtera. L’économie étant mondialisée, les établissements français en subissent évidemment les conséquences. Le montant de leurs pertes s’établit pour l’instant à 14,4 milliards mais pourra évoluer en fonction de la valeur des maisons aux États-Unis. La bonne nouvelle, c’est que ces pertes n’entraînent des résultats mauvais ou catastrophiques pour aucun établissement français ; sans la fraude qu’elle a subie par ailleurs, la Société générale aurait gagné plus de 4 milliards.
Des établissements financiers non bancaires traversent des difficultés de liquidités considérables : la grosse maison de titres Bear Stearns, qui n’a pas le droit de recevoir des dépôts de particuliers, est tombée en quasi-faillite il y a trois semaines et a été rachetée par JP Morgan. Ses clients n’ont subi aucun dommage mais, pour le contribuable américain, cela se traduit par l’inscription en risque de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
De grandes incertitudes macroéconomiques pèsent sur les marchés. Si les États-Unis ralentissent, le monde entier ralentira. Les États-Unis sont en récession aux premier et deuxième trimestres 2008. En Europe, le mouvement à la baisse est inégal et la croissance repose sur des fondamentaux encore solides : la Commission européenne prévoit une croissance de 2 % en 2008 sur le continent. Quant à la croissance française, principalement tirée par la consommation des ménages, elle devrait se maintenir autour de 1,7 % en 2008. N’oublions pas que le centre de l’économie mondiale, qui était situé en Europe il y a cent ans et se trouve aujourd’hui aux États-Unis, tend à se déplacer vers l’Asie. L’économie mondiale continue de croître au rythme satisfaisant de 3,7 %, même s’il est en repli par rapport aux 5 % des années précédentes.
L’affaire de la Société générale n’a aucun rapport avec ces problèmes de risque. La fraude a cours depuis que les banques existent. Des établissements étrangers de taille similaire ont d’ailleurs connu des situations équivalentes de positions dissimulées puis découvertes par la hiérarchie interne, et certains de mes collègues ont bien voulu dire que leur propre banque pourrait être touchée. Le seul lien avec la crise, c’est que nous avons débouclé ces positions dissimulées

Mercredi 9 avril 2008
Séance de 9 heures 30
Compte rendu n° 71
Présidence de M. Didier Migaud, Président
– Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française, sur la crise financière et la régulation des systèmes bancaires
Le Président Didier Migaud : Nous accueillons aujourd’hui M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française, la FBF, et président-directeur général de la Société générale.
La commission des Finances se préoccupe depuis plusieurs mois du développement d’une crise financière internationale dont les effets sur l’économie réelle sont désormais avérés. Cette crise a commencé par une crise du crédit immobilier qui a conduit à une crise bancaire. À ce sujet, nous souhaitons entendre le représentant des banques françaises que vous êtes.
Il se trouve que, dans le même temps, la banque que vous présidez a connu de sérieuses turbulences dues aux prises de position excessives d’un de vos traders, dont les engagements avaient atteint 50 milliards d’euros lorsqu’ils ont été découverts, en janvier dernier. Naturellement, nous nous interrogeons sur la pertinence des contrôles internes à la Société générale mais aussi sur celle des contrôles externes assurés par les régulateurs français ; cette question vaut aussi pour les autres banques puisque certains de vos confrères n’ont pas exclu qu’elles pourraient connaître les mêmes déboires.
La crise des subprimes a eu les effets que l’on sait, en raison d’abord du développement de produits complexes issus d’une titrisation qui s’est emballée ces dernières années, ensuite d’une notation inadéquate, voire défaillante, de produits amalgamant des créances de qualité très inégale et dont le risque n’avait pas fait l’objet d’une identification réelle, enfin d’une diffusion de ces produits dans des marchés interconnectés.
La commission des Finances a entendu à ce sujet, le 2 octobre dernier, les superviseurs des marchés bancaire et financier français, Christian Noyer et Michel Prada, le directeur de la Banque de financement et d’investissement du groupe Société générale, Jean-Pierre Mustier, le directeur général de l’agence de notation Fitch Ratings, Richard Hunter, ainsi que les économistes Michel Aglietta et Henri Bourguinat.
Il nous a semblé, à l’époque, entendre deux économistes inquiets mais quatre acteurs du système financier et bancaire plutôt sereins, même s’ils admettaient que l’économie internationale était relativement incertaine. Selon ces derniers, le problème était plutôt bien circonscrit aux banques américaines, les banques européennes étaient peu affectées par la crise des subprimes, il convenait de relativiser la crise et, par ailleurs, les conditions n’étaient pas réunies pour laisser prévoir un retournement de la croissance.
Aujourd’hui, il apparaît que les banques européennes ne sont pas épargnées. Les pertes déjà enregistrées par les banques françaises et les provisions qu’elles ont passées – de 800 millions d’euros pour la Caisse d’épargne à 4 milliards pour le Crédit agricole – sont moindres, bien moindres que celles des banques les plus exposées, comme UBS, Merril Lynch, Citigroup, HSBC ou Morgan Stanley, mais elles sont élevées et suscitent des interrogations sur le fonctionnement des marchés et des banques.
Au-delà de la sphère financière, c’est l’économie réelle qui est touchée : aux États-Unis, l’ensemble du marché du crédit est affecté par la crise, les rehausseurs de crédit sont sur la sellette, en 2007 les saisies immobilières ont dépassé le million, l’économie est en fort ralentissement, voire en récession. La crise de confiance qui s’est exprimée au travers d’une crise de liquidité interbancaire n’est pas résolue.
La prévention des crises de cette nature devient par conséquent une priorité.
Nous avons reçu récemment Alexandre Lamfalussy, ancien directeur de la Banque des règlements internationaux, la BRI, et du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, qui a souligné le contexte d’asymétrie de l’information dans lequel de nouveaux instruments financiers, mal évalués, avaient été développés et distribués à travers le monde. L’une de nos interrogations porte d’ailleurs sur l’attitude des banques, qui n’ont certes pas, ou pas toutes, distribué des crédits à haut risque mais qui ont acquis des produits en partie composés de ces créances. N’avaient-elles aucune idée du risque qu’ils présentaient ? Faisaient-elles une confiance aveugle aux notations des agences ?
Nous nous sommes interrogés sur les systèmes d’alerte à mettre en place au niveau des marchés et aussi sur l’évolution de l’activité des banques. Étant donné l’ampleur des enjeux financiers, les risques nouveaux sur les activités de marché – risques de crédit, de fraude, de liquidité – et la diversité des activités couvertes par les établissements bancaires, ces derniers devraient-ils infléchir leurs stratégies ? Dans quel sens ?
Vous voudrez bien, dans un premier temps, faire le point, autant qu’il est possible, sur l’affaire de la surexposition de la Société générale par un de ses traders. Nous souhaiterions par exemple que vous nous décriviez les relations existant entre les traders et leur hiérarchie, car nous avons tous été stupéfaits qu’une seule personne puisse mener de telles opérations sur une assez longue période, et que vous nous expliquiez comment sont traitées les alertes venant des marchés. Nous aimerions également recueillir votre analyse de la crise de confiance affectant les marchés bancaire et financier. Puis les membres de notre commission ne manqueront pas de vous poser des questions.
M. Daniel Bouton : Je suis accompagné par Ariane Obolensky, directrice générale de la FBF, qui pourra également répondre à vos questions.
Il est excellent pour la démocratie que votre Commission ait commencé à travailler dès le mois d’octobre sur ce sujet, réservé alors à la planète finance mais qui préoccupe aujourd’hui légitimement tout le monde.
Les entreprises et les banques n’œuvrent pas de manière disjointe. La banque est une industrie et même l’une des principales de France. Nous employons 400 000 salariés et nous recrutons annuellement 40 000 collaborateurs. Nous finançons l’économie à travers 1 400 milliards d’euros de crédits et 1 000 milliards de dépôts. Notre activité représente environ 3 % du PIB.
Nous sommes très divers : la FBF regroupe des établissements coopératifs, mutualistes, mixtes et purement privés, dont deux des plus grandes banques cotées, BNP Paribas et la Société générale.
Nos métiers sont extrêmement variés. L’agence bancaire classique, qui contribue au financement du boulanger ou du serrurier, est bien connue. La chaîne de métiers permettant de financer l’ensemble de l’économie l’est moins. La finance, comme le monde, s’est progressivement ouverte et globalisée. Il y a trente ans, une grande entreprise se finançait essentiellement par des syndicats bancaires. Avec la marchéisation, entamée en France sous l’égide de Bérégovoy, les grandes entreprises se financent directement sur les marchés, ce qui rend les ressources financières moins chères en supprimant la marge d’intermédiation bancaire. Du côté de la ressource, les investisseurs institutionnels – notamment l’État ou le Fonds de réserve pour les retraites – interviennent directement sur les marchés. Aux États-Unis comme en Europe, les banquiers ne sont plus seulement des prêteurs ; ils ont accompagné le mouvement de marchéisation en développant de nouvelles activités sophistiquées car une banque qui n’évolue pas est condamnée à périr. Grâce au talent de ses banquiers, dans les deux grands établissements cotés mais aussi au Crédit agricole à travers sa filiale Calyon ou à la Banque populaire à travers sa filiale Natixis, la France est l’un des seuls pays au monde à disposer d’une vraie industrie de la finance sophistiquée.
Je vais vous décrire deux métiers.
Le premier est celui de la titrisation. Au milieu des années cinquante, les quelques centaines de milliers de ménages français susceptibles d’acheter une voiture n’ont pas accès au crédit. La Compagnie bancaire lance alors le premier crédit à la consommation. Mais, puisque l’État pompe la totalité de l’épargne française, La Compagnie bancaire doit se financer court et transformer ces ressources en créances à quatre ans. Un peu plus tard, la titrisation est inventée : au lieu de transformer l’épargne, l’établissement bancaire vend directement aux investisseurs du marché financier les créances à quatre ans qu’il détient sur les particuliers en les regroupant en paquets. Aujourd’hui, en Europe, la titrisation représente 460 milliards d’euros. Ce volume subit toutefois une baisse considérable depuis le début 2008 ; le crédit, moteur du financement de l’économie, manque par conséquent d’une ressource considérable.
Le second métier dont je vais vous entretenir a été rendu célèbre pas la position dissimulée du fraudeur : ce sont les activités pour compte propre. Contrairement aux fonds spéculatifs, les banques ne prennent jamais de positions directionnelles importantes sur la hausse du dollar ou la baisse du pétrole par exemple. Nous divisons le risque pour le maîtriser. La découverte d’une position dissimulée peut donc poser des problèmes considérables. Je signale au passage que la fraude a toujours existé dans l’histoire des banques et qu’elle existera toujours. La part des activités pour compte propre des banques françaises est faible, voire très faible.
Le monde de l’économie réelle et le monde financier ne sont pas séparés. La financiarisation de l’économie permet de financer la croissance ; sans elle, le monde occidental n’aurait pas connu son formidable développement. Les banques françaises figurant parmi les plus performantes et les plus reconnues dans certains métiers, l’économie française est l’une des principales bénéficiaires de la titrisation.
Cela dit, la crise née aux États-Unis est très grave.
La crise originelle a été bien analysée dans vos auditions précédentes. Dans certains États américains, des crédits immobiliers peuvent être distribués par des courtiers, c’est-à-dire des intermédiaires échappant aux régulations et contrôles applicables au secteur bancaire. Pour leur part, les banques françaises sont favorables à un contrôle de la distribution du crédit et de la circulation de la monnaie par des régulateurs puissants. Depuis trois ou quatre ans, les courtiers américains n’examinaient plus les capacités de remboursement de l’emprunteur mais uniquement la valeur du gage, c’est-à-dire de la maison. Le niveau de protection du consommateur est extrêmement variable d’un État à l’autre, tout comme en Europe, du reste. Toutefois, chez nous, la loi bancaire interdit à quiconque de prêter de l’argent s’il ne possède pas le statut de banque.
Le deuxième facteur de la crise est la dissémination du risque. Nous sommes partisans de la titrisation. Une crise bancaire classique se transforme en crise économique générale parce qu’une banque saute et propage la crise dans la région, le pays, voire le monde. La titrisation permet de distribuer et de disséminer le risque. Mais cela repose, pour bien fonctionner, sur trois conditions qui n’étaient pas totalement réunies au moment de l’explosion : les produits doivent être visibles ; les engagements des émetteurs doivent être clairs ; les investisseurs doivent être capables d’apprécier à quoi correspondent les créances et ne pas se référer uniquement au rating des agences indépendantes.
Troisièmement, les banques ont des engagements résiduels dans certains produits titrisés sophistiqués. Selon leur politique propre et les règles de régulation nationales, elles peuvent laisser tomber un produit – ce sont alors les investisseurs qui assument la totalité de la perte – ou au contraire prendre un engagement de liquidité, voire intégrer cette participation dans leur bilan. Or certains contrats concernant de tels véhicules contenaient des imperfections et n’étaient pas parfaitement clairs.
Sur ces trois chapitres, tout n’était donc pas parfaitement clair ; la crise financière part de là. Au-delà de la crise des subprimes, qui mettra à la rue 2,2 millions de ménages américains, le manque de clarté entraînera une méfiance généralisée vis-à-vis des marchés financiers et même vis-à-vis des bilans des banques américaines.
Nul ne sait encore combien cette crise coûtera. L’économie étant mondialisée, les établissements français en subissent évidemment les conséquences. Le montant de leurs pertes s’établit pour l’instant à 14,4 milliards mais pourra évoluer en fonction de la valeur des maisons aux États-Unis. La bonne nouvelle, c’est que ces pertes n’entraînent des résultats mauvais ou catastrophiques pour aucun établissement français ; sans la fraude qu’elle a subie par ailleurs, la Société générale aurait gagné plus de 4 milliards.
Des établissements financiers non bancaires traversent des difficultés de liquidités considérables : la grosse maison de titres Bear Stearns, qui n’a pas le droit de recevoir des dépôts de particuliers, est tombée en quasi-faillite il y a trois semaines et a été rachetée par JP Morgan. Ses clients n’ont subi aucun dommage mais, pour le contribuable américain, cela se traduit par l’inscription en risque de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
De grandes incertitudes macroéconomiques pèsent sur les marchés. Si les États-Unis ralentissent, le monde entier ralentira. Les États-Unis sont en récession aux premier et deuxième trimestres 2008. En Europe, le mouvement à la baisse est inégal et la croissance repose sur des fondamentaux encore solides : la Commission européenne prévoit une croissance de 2 % en 2008 sur le continent. Quant à la croissance française, principalement tirée par la consommation des ménages, elle devrait se maintenir autour de 1,7 % en 2008. N’oublions pas que le centre de l’économie mondiale, qui était situé en Europe il y a cent ans et se trouve aujourd’hui aux États-Unis, tend à se déplacer vers l’Asie. L’économie mondiale continue de croître au rythme satisfaisant de 3,7 %, même s’il est en repli par rapport aux 5 % des années précédentes.
L’affaire de la Société générale n’a aucun rapport avec ces problèmes de risque. La fraude a cours depuis que les banques existent. Des établissements étrangers de taille similaire ont d’ailleurs connu des situations équivalentes de positions dissimulées puis découvertes par la hiérarchie interne, et certains de mes collègues ont bien voulu dire que leur propre banque pourrait être touchée. Le seul lien avec la crise, c’est que nous avons débouclé ces positions dissimulées

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
dans des conditions de marché épouvantables, ce qui nous a coûté les 5 milliards que vous savez.
Cette fraude ne remet absolument pas en cause nos systèmes de mesure et de valorisation du risque car les positions prises étaient dissimulées. C’est d’ailleurs pourquoi la Société générale se porte aujourd’hui très bien, y compris dans ses activités de marché : nous subissons comme tout le monde les effets de la crise mais aucune perte de confiance de la part des centaines d’opérateurs financiers qui travaillent avec nous ni aucun mouvement significatif de peur de la part de nos clients.
Cela étant, un fraudeur a utilisé des techniques, parfois simples, parfois sophistiquées, pour déjouer nos dispositifs de contrôle interne. Dès le quatrième jour, nous avons annoncé l’instauration de nouveaux contrôles manuels afin d’éviter qu’une telle fraude se reproduise. D’autres établissements qui ne les avaient pas encore adoptés viennent aussi de le faire.
L’intervention d’Eurex ne laissait rien présager d’anormal car les superviseurs de marché envoient 300 questions par an pour les seules salles actions de la Société générale. Mais la procédure suit son cours, qu’il s’agisse de l’enquête de la police, de celle de la Commission bancaire (René: non compétente dans "le pays" des "XPF"....) ou de celle du conseil d’administration de la Société générale, pilotée par un comité spécial composé d’administrateurs indépendants. Les conclusions de la première phase sont disponibles sur notre site et celles de la deuxième phase le seront fin mai.
Nous avons réaffirmé notre stratégie, nous sommes allés à la rencontre des marchés et nous avons réclamé à nos propriétaires davantage que ce que nous avions perdu. L’augmentation de capital a été bouclée avec succès en six semaines environ et nous en rendrons compte devant les actionnaires lors de notre assemblée générale de fin mai. Je rappelle que la Société générale, malgré cette fraude exceptionnelle et les conditions du marché, a gagné 1 milliard d’euros en 2007.
Comment faire pour sortir de la crise générale des marchés ? Des papiers publiés par des organes de régulation internationaux – notamment le rapport intérimaire du Forum de stabilité financière de début février ou le rapport du conseil Écofin du 4 mars – commencent à dégager des clés intéressantes.
Un sujet de préoccupation concerne la méthode de valorisation des actifs pour les marchés non liquides. Si aucune transaction immobilière n’intervient dans une ville donnée pendant un certain temps, compte tenu du système de valorisation adopté il y a quelques années par les instances européennes, la première vente déterminera à elle seule le prix du marché. Si cette vente se conclut à vil prix, le système diffusera la crise. Il n’est pas question d’édicter de nouvelles règles dans la situation actuelle mais, une fois la crise terminée, il faudra se pencher sérieusement sur cette fair market value, que certains n’hésitent plus à qualifier d’unfair market value.
Pour restaurer la confiance, les banques doivent réévaluer leurs actifs de façon réaliste et surtout déclarer clairement et entièrement leur exposition au risque sur ces produits structurés, afin que le marché puisse effectuer ses arbitrages. Les grands établissements ont pris des décisions allant dans ce sens à l’occasion de leurs résultats de fin d’année.
Par ailleurs, les superviseurs et les régulateurs – ceux du marché boursier et du marché bancaire français sont considérés à l’étranger comme faisant partie des meilleurs – doivent imposer à ceux qui ne l’ont pas encore fait, à supposer qu’il en reste, de déclarer complètement leurs risques et leurs positions. Je pense en tout cas que le contrôle des niveaux de capitalisation par les régulateurs ne pose aucun problème ; je précise au passage que celui des banques françaises s’établit au taux tout à fait adéquat de 8 %.
Je suis incapable d’apprécier l’action des banques centrales. Néanmoins, de ma position de dirigeant d’une grande banque régulée active en France, en Europe et aux États-Unis (René: et à 80% à TAHITI dans la banque de Polynésie), j’ai l’impression que leur gestion de la liquidité, pendant toute la période récente, a été extrêmement efficace.
La régulation bancaire peut-elle être améliorée ? Nous sommes en train de passer de Bâle I, système tout simple et normatif, à Bâle II, plus sophistiqué et bien meilleur. Toute norme incite les acteurs à s’en approcher : si la vitesse est limitée à 90 kilomètres/heure, tout le monde roulera entre 85 et 89 kilomètres/heure, sans parler de ceux qui iront trop vite. Bâle II ressemble plutôt à l’injonction faite aux automobilistes de rester maîtres de leur vitesse en toutes circonstances, le système étant assorti de dispositifs de mesure. Bâle II aurait eu une efficacité supérieure à Bâle I puisqu’il prévoit la prise en considération des engagements hors bilan. Des ajustements marginaux seront peut-être nécessaires au vu de l’expérience mais Bâle II constitue un progrès aux yeux de la Société générale comme de la plupart des autres grandes banques.
En revanche, les agences de notation doivent changer de méthode. Elles procèdent comme M. Robert Parker, spécialiste du rating dans le domaine de l’œnologie, qui utilise l’échelle de 0 à 100 indistinctement pour un Pomerol et un Côte de Nuits. Un AAA n’a pourtant pas la même signification selon qu’il évalue la dette de la France ou un produit structuré. En effet, l’État est actif, il peut améliorer ses finances publiques – c’est ce que vous avez fait, par exemple, avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF –, tandis qu’un papier structuré est passif, il ne peut être modifié. Les agences devraient donc employer des échelles de notation différentes.
La coordination entre les autorités de régulation et de supervision est déjà excellente en France, ce qui n’est manifestement pas le cas en Grande-Bretagne, l’affaire Northern Rock l’a démontré. Le secrétaire au trésor américain, Henry Paulson, vient de lancer un grand projet qui revient à critiquer l’organisation en vigueur, avec des agences fragmentées par État. En Europe, nous ne prenons pas le chemin d’une agence unique de régulation car les États membres y sont défavorables, contrairement aux grandes banques du continent, qui préconisent une harmonisation des règles et un organe commun de supervision afin de créer une culture commune et de favoriser une concurrence saine sur tous les marchés. Mais cette décision dépend des parlements nationaux de chacun des États de l’espace européen.
M. Henri Emmanuelli : Ce n’est pas pour demain ! Il faut attaquer le Luxembourg !
M. Daniel Bouton : L’activité financière, en particulier celle qui se déploie sur la place de Paris, constitue un atout pour notre pays. Outre l’aéronautique, il est leader mondial dans plusieurs activités industrielles comme la gestion d’actifs, les financements structurés et, malgré la fraude constatée à la Société générale, les dérivés actions. Il faut savoir que la banque britannique HSBC a transféré ses pôles dérivés actions à Paris, compte tenu de la qualité du dispositif français de contrôle des risques, du bon dialogue entre les régulateurs et du potentiel de professionnels bien formés dans les grandes écoles – BNP Paribas et la Société générale emploient respectivement 140 et 130 polytechniciens.
Bref, avoir de grandes banques est un atout important pour la France. Votre Commission pourrait avoir une réflexion sur ce thème lorsque la crise n’aura plus de retombées. Nos concurrentes anglo-saxonnes installées à Londres ont un intérêt objectif à faire croire que la situation de la place de Paris est catastrophique ; nous le comprenons, c’est le jeu de la concurrence, mais ne tombons pas dans le panneau. L’expertise financière française est appréciée. Nous devons continuer d’attirer à Paris les meilleurs talents, qui drainent toute l’industrie financière. Les banques françaises présentent la particularité de maintenir à Paris leurs activités essentielles de banque d’investissement ; 20 % seulement des activités de Société générale, par exemple, sont localisées à Londres.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Estimez-vous que le processus de dévalorisation d’actifs, corrélé à la méfiance vis-à-vis des marchés, est aujourd’hui interrompu et que nous sommes entrés dans une phase de stabilisation ?
Au regard de l’extrême complexité des produits non structurés, n’est-il pas illusoire de chercher à améliorer leur traçabilité et leur évaluation ? L’inventivité des concepteurs de ces produits ne leur donnera-t-elle pas toujours une longueur d’avance sur les dispositifs de contrôle ?
La panne du moteur de la titrisation ne provoque-t-elle pas par un resserrement ou un renchérissement du crédit ? Ce phénomène, observé depuis six mois pour les prêts immobiliers aux ménages, ne risque-t-il pas de s’étendre au financement des entreprises, en particulier des PME ?
Après la réussite de sa recapitalisation, quelles sont les perspectives de la Société générale ?
Madame Obolensky, au-delà de son rôle bien connu de lobbying, la FBF organise-t-elle des échanges d’informations et d’expertises entre ses adhérents sur le sujet de l’organisation des contrôles internes ou bien celui-ci est-il tabou ? La surveillance du risque est-elle du seul ressort de la Commission bancaire ?
M. Daniel Bouton : Il n’y a aucune raison que le volume de crédit se resserre en France. Si une banque prêtait à un ménage ou à une entreprise insolvable il y a six mois, c’est une mauvaise banque. Notre métier a toujours consisté en permanence à prêter en espérant raisonnablement nous faire rembourser. Seul le prix du crédit joue.
M. Michel Bouvard : Et le credit crunch ?
M. Daniel Bouton : Il n’y en a pas. Notre ratio de fonds propres est de 8 %. Si vous avez un bon dossier, envoyez-le à la Société générale, nous disposons des capitaux propres nécessaires. Mais nous savons détecter les mauvais dossiers.
M. Henri Emmanuelli : C’est pour eux que le système coince.
M. Daniel Bouton : Nous n’avons pas vocation à financer des emprunteurs insolvables.
La FBF ne s’occupe pas des contrôles internes ; des brigades de policiers ne sont pas déployées pour se substituer aux contrôles internes. Le système de contrôle comporte plusieurs niveaux. La Société générale emploie quelque 2 000 auditeurs. Ceux-ci ne reprennent pas les opérations une à une – on en compte des milliards – mais vérifient que notre système interne fonctionne bien. Cette architecture, définie dans le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière, est la bonne.
Je ne résiste pas à vous traduire une phrase de The Economist de ce matin : « Un système financier sophistiqué et innovant peut déboucher sur des booms destructeurs. Mais un système trop régulé condamne l’économie à une croissance lente. » C’est toute la difficulté pour le législateur et le régulateur : où se situe le bon équilibre entre, d’une part, trop de régulation mais une croissance lente, et, d’autre part, trop d’innovation mais un risque de boom comparable à celui qui vient de se produire aux États-Unis ?
Je suis en désaccord avec une thèse popularisée en France par Philippe Ries, journaliste ici présent. La crise s’est exportée des États-Unis vers l’Europe tout comme la prospérité s’était exportée des États-Unis vers l’Europe pendant la période précédente. Dans un monde interconnecté, si la France tousse, l’Allemagne ne se porte pas bien, si la croissance ralentit en Espagne, la France en subit les conséquences, et, si les États-Unis vont mal, nous souffrons avec eux. Essayons d’aider les États-Unis car notre propre santé en dépend.
Le Président Didier Migaud : Au début de la crise, ces évidences étaient niées !
M. Daniel Bouton : La réalité de la crise elle-même était niée !
M. Jérôme Cahuzac : La modestie de vos propos, monsieur le président, ainsi que les incertitudes sous-jacentes à certaines de vos déclarations augurent bien d’un dialogue plus propice à la confiance que des vérités assénées comme des évidences d’on ne sait quel Olympe bancaire. Je vous remercie donc du ton de votre intervention.
Vous avez souligné l’importance des banques dans notre économie, donc de la responsabilité qui est la vôtre. Autrement dit, quand une banque comme la vôtre court un risque pour elle-même et pour la place, ce risque se mesure à l’aune de cette importance. Estimez-vous, au regard de la crise que vous avez connue, que le licenciement sec d’un « fraudeur » – terme que vous utilisez désormais, plutôt que celui de « terroriste » – et l’amputation de la rémunération de certains dirigeants sont à la hauteur du risque encouru par votre entreprise et par la place ?
À propos des banques américaines, vous vous êtes demandé s’il fallait les croire. Je vous demande à mon tour : faut-il croire les banques françaises ?
Estimez-vous que le nombre important de polytechniciens travaillant dans ces établissements est un gage de confiance ? Subsidiairement, la devise de l’École polytechnique qui est « pour la patrie, les sciences et la gloire » doit-elle être complétée par « pour les banques » ? Avant le mot « patrie » ? Ou après le mot « gloire » ? Nonobstant la grande qualité des ceux qui en sortent, estimez-vous que le recrutement est à revoir pour éviter une crise comme celle que vous avez pu connaître ?
Vous avez développé un modèle de croissance interne original en France, fruit d’une décision à la fois librement consentie et quelque peu contrainte, si l’on se souvient de certains échecs – je pense à l’OPA sur Paribas. Estimez-vous que ce modèle de croissance interne, fondé sur des résultats qui, pour près de la moitié, proviennent précisément des activités du fraudeur en question, a vécu ? Faudrait-il le corriger pour éviter les incidents, et même les accidents ?
Vous avez déclaré l’année dernière, avant que n’éclate la crise elle-même, que votre groupe, la Société Générale, n’était exposé qu’indirectement, et de manière marginale, aux différentes activités liées aux subprimes. Estimez-vous, après la perte de cinq milliards d’euros, que ce soit toujours le cas ?
M. Daniel Bouton : N’étant pas polytechnicien et n’ayant pas le talent rhétorique d’un homme politique, vous me pardonnerez de ne pas répondre à la question sur l’École polytechnique…
Ce qu’ignorent certains commentaires sur la
Cette fraude ne remet absolument pas en cause nos systèmes de mesure et de valorisation du risque car les positions prises étaient dissimulées. C’est d’ailleurs pourquoi la Société générale se porte aujourd’hui très bien, y compris dans ses activités de marché : nous subissons comme tout le monde les effets de la crise mais aucune perte de confiance de la part des centaines d’opérateurs financiers qui travaillent avec nous ni aucun mouvement significatif de peur de la part de nos clients.
Cela étant, un fraudeur a utilisé des techniques, parfois simples, parfois sophistiquées, pour déjouer nos dispositifs de contrôle interne. Dès le quatrième jour, nous avons annoncé l’instauration de nouveaux contrôles manuels afin d’éviter qu’une telle fraude se reproduise. D’autres établissements qui ne les avaient pas encore adoptés viennent aussi de le faire.
L’intervention d’Eurex ne laissait rien présager d’anormal car les superviseurs de marché envoient 300 questions par an pour les seules salles actions de la Société générale. Mais la procédure suit son cours, qu’il s’agisse de l’enquête de la police, de celle de la Commission bancaire (René: non compétente dans "le pays" des "XPF"....) ou de celle du conseil d’administration de la Société générale, pilotée par un comité spécial composé d’administrateurs indépendants. Les conclusions de la première phase sont disponibles sur notre site et celles de la deuxième phase le seront fin mai.
Nous avons réaffirmé notre stratégie, nous sommes allés à la rencontre des marchés et nous avons réclamé à nos propriétaires davantage que ce que nous avions perdu. L’augmentation de capital a été bouclée avec succès en six semaines environ et nous en rendrons compte devant les actionnaires lors de notre assemblée générale de fin mai. Je rappelle que la Société générale, malgré cette fraude exceptionnelle et les conditions du marché, a gagné 1 milliard d’euros en 2007.
Comment faire pour sortir de la crise générale des marchés ? Des papiers publiés par des organes de régulation internationaux – notamment le rapport intérimaire du Forum de stabilité financière de début février ou le rapport du conseil Écofin du 4 mars – commencent à dégager des clés intéressantes.
Un sujet de préoccupation concerne la méthode de valorisation des actifs pour les marchés non liquides. Si aucune transaction immobilière n’intervient dans une ville donnée pendant un certain temps, compte tenu du système de valorisation adopté il y a quelques années par les instances européennes, la première vente déterminera à elle seule le prix du marché. Si cette vente se conclut à vil prix, le système diffusera la crise. Il n’est pas question d’édicter de nouvelles règles dans la situation actuelle mais, une fois la crise terminée, il faudra se pencher sérieusement sur cette fair market value, que certains n’hésitent plus à qualifier d’unfair market value.
Pour restaurer la confiance, les banques doivent réévaluer leurs actifs de façon réaliste et surtout déclarer clairement et entièrement leur exposition au risque sur ces produits structurés, afin que le marché puisse effectuer ses arbitrages. Les grands établissements ont pris des décisions allant dans ce sens à l’occasion de leurs résultats de fin d’année.
Par ailleurs, les superviseurs et les régulateurs – ceux du marché boursier et du marché bancaire français sont considérés à l’étranger comme faisant partie des meilleurs – doivent imposer à ceux qui ne l’ont pas encore fait, à supposer qu’il en reste, de déclarer complètement leurs risques et leurs positions. Je pense en tout cas que le contrôle des niveaux de capitalisation par les régulateurs ne pose aucun problème ; je précise au passage que celui des banques françaises s’établit au taux tout à fait adéquat de 8 %.
Je suis incapable d’apprécier l’action des banques centrales. Néanmoins, de ma position de dirigeant d’une grande banque régulée active en France, en Europe et aux États-Unis (René: et à 80% à TAHITI dans la banque de Polynésie), j’ai l’impression que leur gestion de la liquidité, pendant toute la période récente, a été extrêmement efficace.
La régulation bancaire peut-elle être améliorée ? Nous sommes en train de passer de Bâle I, système tout simple et normatif, à Bâle II, plus sophistiqué et bien meilleur. Toute norme incite les acteurs à s’en approcher : si la vitesse est limitée à 90 kilomètres/heure, tout le monde roulera entre 85 et 89 kilomètres/heure, sans parler de ceux qui iront trop vite. Bâle II ressemble plutôt à l’injonction faite aux automobilistes de rester maîtres de leur vitesse en toutes circonstances, le système étant assorti de dispositifs de mesure. Bâle II aurait eu une efficacité supérieure à Bâle I puisqu’il prévoit la prise en considération des engagements hors bilan. Des ajustements marginaux seront peut-être nécessaires au vu de l’expérience mais Bâle II constitue un progrès aux yeux de la Société générale comme de la plupart des autres grandes banques.
En revanche, les agences de notation doivent changer de méthode. Elles procèdent comme M. Robert Parker, spécialiste du rating dans le domaine de l’œnologie, qui utilise l’échelle de 0 à 100 indistinctement pour un Pomerol et un Côte de Nuits. Un AAA n’a pourtant pas la même signification selon qu’il évalue la dette de la France ou un produit structuré. En effet, l’État est actif, il peut améliorer ses finances publiques – c’est ce que vous avez fait, par exemple, avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF –, tandis qu’un papier structuré est passif, il ne peut être modifié. Les agences devraient donc employer des échelles de notation différentes.
La coordination entre les autorités de régulation et de supervision est déjà excellente en France, ce qui n’est manifestement pas le cas en Grande-Bretagne, l’affaire Northern Rock l’a démontré. Le secrétaire au trésor américain, Henry Paulson, vient de lancer un grand projet qui revient à critiquer l’organisation en vigueur, avec des agences fragmentées par État. En Europe, nous ne prenons pas le chemin d’une agence unique de régulation car les États membres y sont défavorables, contrairement aux grandes banques du continent, qui préconisent une harmonisation des règles et un organe commun de supervision afin de créer une culture commune et de favoriser une concurrence saine sur tous les marchés. Mais cette décision dépend des parlements nationaux de chacun des États de l’espace européen.
M. Henri Emmanuelli : Ce n’est pas pour demain ! Il faut attaquer le Luxembourg !
M. Daniel Bouton : L’activité financière, en particulier celle qui se déploie sur la place de Paris, constitue un atout pour notre pays. Outre l’aéronautique, il est leader mondial dans plusieurs activités industrielles comme la gestion d’actifs, les financements structurés et, malgré la fraude constatée à la Société générale, les dérivés actions. Il faut savoir que la banque britannique HSBC a transféré ses pôles dérivés actions à Paris, compte tenu de la qualité du dispositif français de contrôle des risques, du bon dialogue entre les régulateurs et du potentiel de professionnels bien formés dans les grandes écoles – BNP Paribas et la Société générale emploient respectivement 140 et 130 polytechniciens.
Bref, avoir de grandes banques est un atout important pour la France. Votre Commission pourrait avoir une réflexion sur ce thème lorsque la crise n’aura plus de retombées. Nos concurrentes anglo-saxonnes installées à Londres ont un intérêt objectif à faire croire que la situation de la place de Paris est catastrophique ; nous le comprenons, c’est le jeu de la concurrence, mais ne tombons pas dans le panneau. L’expertise financière française est appréciée. Nous devons continuer d’attirer à Paris les meilleurs talents, qui drainent toute l’industrie financière. Les banques françaises présentent la particularité de maintenir à Paris leurs activités essentielles de banque d’investissement ; 20 % seulement des activités de Société générale, par exemple, sont localisées à Londres.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Estimez-vous que le processus de dévalorisation d’actifs, corrélé à la méfiance vis-à-vis des marchés, est aujourd’hui interrompu et que nous sommes entrés dans une phase de stabilisation ?
Au regard de l’extrême complexité des produits non structurés, n’est-il pas illusoire de chercher à améliorer leur traçabilité et leur évaluation ? L’inventivité des concepteurs de ces produits ne leur donnera-t-elle pas toujours une longueur d’avance sur les dispositifs de contrôle ?
La panne du moteur de la titrisation ne provoque-t-elle pas par un resserrement ou un renchérissement du crédit ? Ce phénomène, observé depuis six mois pour les prêts immobiliers aux ménages, ne risque-t-il pas de s’étendre au financement des entreprises, en particulier des PME ?
Après la réussite de sa recapitalisation, quelles sont les perspectives de la Société générale ?
Madame Obolensky, au-delà de son rôle bien connu de lobbying, la FBF organise-t-elle des échanges d’informations et d’expertises entre ses adhérents sur le sujet de l’organisation des contrôles internes ou bien celui-ci est-il tabou ? La surveillance du risque est-elle du seul ressort de la Commission bancaire ?
M. Daniel Bouton : Il n’y a aucune raison que le volume de crédit se resserre en France. Si une banque prêtait à un ménage ou à une entreprise insolvable il y a six mois, c’est une mauvaise banque. Notre métier a toujours consisté en permanence à prêter en espérant raisonnablement nous faire rembourser. Seul le prix du crédit joue.
M. Michel Bouvard : Et le credit crunch ?
M. Daniel Bouton : Il n’y en a pas. Notre ratio de fonds propres est de 8 %. Si vous avez un bon dossier, envoyez-le à la Société générale, nous disposons des capitaux propres nécessaires. Mais nous savons détecter les mauvais dossiers.
M. Henri Emmanuelli : C’est pour eux que le système coince.
M. Daniel Bouton : Nous n’avons pas vocation à financer des emprunteurs insolvables.
La FBF ne s’occupe pas des contrôles internes ; des brigades de policiers ne sont pas déployées pour se substituer aux contrôles internes. Le système de contrôle comporte plusieurs niveaux. La Société générale emploie quelque 2 000 auditeurs. Ceux-ci ne reprennent pas les opérations une à une – on en compte des milliards – mais vérifient que notre système interne fonctionne bien. Cette architecture, définie dans le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière, est la bonne.
Je ne résiste pas à vous traduire une phrase de The Economist de ce matin : « Un système financier sophistiqué et innovant peut déboucher sur des booms destructeurs. Mais un système trop régulé condamne l’économie à une croissance lente. » C’est toute la difficulté pour le législateur et le régulateur : où se situe le bon équilibre entre, d’une part, trop de régulation mais une croissance lente, et, d’autre part, trop d’innovation mais un risque de boom comparable à celui qui vient de se produire aux États-Unis ?
Je suis en désaccord avec une thèse popularisée en France par Philippe Ries, journaliste ici présent. La crise s’est exportée des États-Unis vers l’Europe tout comme la prospérité s’était exportée des États-Unis vers l’Europe pendant la période précédente. Dans un monde interconnecté, si la France tousse, l’Allemagne ne se porte pas bien, si la croissance ralentit en Espagne, la France en subit les conséquences, et, si les États-Unis vont mal, nous souffrons avec eux. Essayons d’aider les États-Unis car notre propre santé en dépend.
Le Président Didier Migaud : Au début de la crise, ces évidences étaient niées !
M. Daniel Bouton : La réalité de la crise elle-même était niée !
M. Jérôme Cahuzac : La modestie de vos propos, monsieur le président, ainsi que les incertitudes sous-jacentes à certaines de vos déclarations augurent bien d’un dialogue plus propice à la confiance que des vérités assénées comme des évidences d’on ne sait quel Olympe bancaire. Je vous remercie donc du ton de votre intervention.
Vous avez souligné l’importance des banques dans notre économie, donc de la responsabilité qui est la vôtre. Autrement dit, quand une banque comme la vôtre court un risque pour elle-même et pour la place, ce risque se mesure à l’aune de cette importance. Estimez-vous, au regard de la crise que vous avez connue, que le licenciement sec d’un « fraudeur » – terme que vous utilisez désormais, plutôt que celui de « terroriste » – et l’amputation de la rémunération de certains dirigeants sont à la hauteur du risque encouru par votre entreprise et par la place ?
À propos des banques américaines, vous vous êtes demandé s’il fallait les croire. Je vous demande à mon tour : faut-il croire les banques françaises ?
Estimez-vous que le nombre important de polytechniciens travaillant dans ces établissements est un gage de confiance ? Subsidiairement, la devise de l’École polytechnique qui est « pour la patrie, les sciences et la gloire » doit-elle être complétée par « pour les banques » ? Avant le mot « patrie » ? Ou après le mot « gloire » ? Nonobstant la grande qualité des ceux qui en sortent, estimez-vous que le recrutement est à revoir pour éviter une crise comme celle que vous avez pu connaître ?
Vous avez développé un modèle de croissance interne original en France, fruit d’une décision à la fois librement consentie et quelque peu contrainte, si l’on se souvient de certains échecs – je pense à l’OPA sur Paribas. Estimez-vous que ce modèle de croissance interne, fondé sur des résultats qui, pour près de la moitié, proviennent précisément des activités du fraudeur en question, a vécu ? Faudrait-il le corriger pour éviter les incidents, et même les accidents ?
Vous avez déclaré l’année dernière, avant que n’éclate la crise elle-même, que votre groupe, la Société Générale, n’était exposé qu’indirectement, et de manière marginale, aux différentes activités liées aux subprimes. Estimez-vous, après la perte de cinq milliards d’euros, que ce soit toujours le cas ?
M. Daniel Bouton : N’étant pas polytechnicien et n’ayant pas le talent rhétorique d’un homme politique, vous me pardonnerez de ne pas répondre à la question sur l’École polytechnique…
Ce qu’ignorent certains commentaires sur la

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
position dissimulée dont j’ai parlé, et qui est pourtant fondamental, c’est que ce n’est pas notre métier. Une banque, même plus grosse que la nôtre – nous sommes tout de même parmi les vingt premières banques du monde par la capitalisation – n’aime pas prendre une position, même d’un milliard d’euros. Nous divisons le risque. Les 50 milliards de positions dissimulées n’ont rien à voir avec notre métier. Vous avez souligné que nous avions eu la meilleure performance boursière de toutes les banques européennes sur la période 2000-2007. J’espère que les 155 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise seront capables de retrouver une décennie de profits.
Les banques françaises sont connues de tout le monde pour deux caractéristiques. La première est la bonne qualité des services rendus. Je parle pour mes concurrents comme pour la Société Générale, même si je pense que la Société Générale est « plus meilleure ». La seconde est la tarification, qui est très basse pour les crédits, et qui, pour les services, se situe dans la moyenne européenne. Toutes les enquêtes européennes montrent que c’est en France que l’on finance son logement le moins cher et que les paniers de services, qu’ils soient publiés par la Commission européenne ou par les organismes de consommateurs, nous placent à peu près dans la moyenne européenne. Comme je ne critique jamais tel ou tel de mes concurrents qui annonce un profit warning, j’ai le plaisir d’indiquer que la solidité des banques françaises est telle qu’elles sont capables d’encaisser et de résister dans un monde dans lequel le prix des maisons continuerait à baisser. C’est le métier des banques que de prendre en charge le coût du risque, qui est plus élevé quand le cycle est mauvais que quand il est bon. Ne vous inquiétez pas.
Le Rapporteur général : Cela veut-il dire que quand on vit dangereusement, on fait davantage de profit ?
M. Daniel Bouton : Il est sûr que la banque qui ne prête jamais d’argent n’existe pas et qu’en tout état de cause, elle ne gagne rien. La seule banque qui ne courrait pas de risque, ce serait une banque privée qui utiliserait l’argent de ses clients uniquement pour acheter des bons du Trésor de l’État français.
M. Henri Emmanuelli : Dexia ?
M. Daniel Bouton : En France, vous le savez, une collectivité locale du Poitou a connu des difficultés considérables !
Le Président Didier Migaud : C’est peu de chose !
M. Daniel Bouton : Nous mesurons le risque de défaillance des collectivités locales. D’ailleurs, elles demandent des ratings. Par ailleurs, heureusement que nous avons des clients qui présentent des risques extrêmement faibles !
M. Henri Emmanuelli : J’ai parlé de Dexia, pas de la Société Générale.
M. Daniel Bouton : Mais nous avons des prêts aux collectivités locales ! J’espère que vous n’imaginez pas qu’il puisse y avoir un monopole dans une quelconque activité bancaire : les caisses d’épargne, la Société Générale ou Dexia sont sur ce créneau.
Le Rapporteur général : Une précision à propos de la rentabilité de la Société Générale, supérieure à celle de ses concurrents. Cette banque a également subi un risque exceptionnel. Sans établir de relation entre les deux…
M. Daniel Bouton : Non ! Aucun rapport. Il y a eu fraude !
Le Rapporteur général : on sent bien que plus de risque entraîne plus de rentabilité, mais que plus de risque peut aussi provoquer plus de pépins.
M. Daniel Bouton : Tout le monde le sait, la banque de financement et d’investissement – la BFI – représente 29 % des capitaux propres à la Société Générale, contre 36 %, je crois, chez BNP-Paribas, notre plus grand concurrent. Il faut l’avoir à l’esprit. Nous avons atteint en fin de cycle, sur 2005-2006-2007, des niveaux de rentabilité qui ne sont pas récurrents. Tout le monde en est conscient sur le marché. La Société Générale, ou la BNP, aurait été valorisée trois fois son prix d’aujourd’hui si elle avait eu une BFI dégageant des résultats comme au sommet du cycle. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est normal que, quand un secteur économique va bien, les profits soient plus élevés et que, quand la conjoncture va un peu moins bien, les profits soient un peu plus bas. Les banques françaises, malgré la crise actuelle, sont en situation de gagner des milliards d’euros cumulés en 2008. Je suis très heureux d’être ici en train de me faire enguirlander parce que les profits anticipés des banques françaises en 2008 vous semblent un peu faibles, monsieur le Rapporteur général…
Le Président Didier Migaud : Une question n’a pas encore abordée, celle de la fraude ou des actions dissimulées. Comment cette dissimulation a-t-elle pu durer aussi longtemps et prendre pareille importance ? On a lu ici ou là que ne pas prendre de vacances pouvait paraître suspect. Pourquoi les contrôles opérés n’ont-ils pas eu de suite ? On a lu aussi que, tant que ce trader faisait gagner de l’argent, on n’était pas regardant, et que la question ne s’était posée qu’à partir du moment où certains seuils avaient été dépassés. Ce sont des questions que tout le monde se pose et, honnêtement, nous ne sommes pas entièrement convaincus par les réponses qui nous sont apportées.
M. Daniel Bouton : Puis-je suggérer à la représentation nationale de bien vouloir lire non pas ce qui a été écrit en qualité de roman dans tel ou tel journal…
M. Jean-François Lamour : Nous ne lisons pas que des romans !
M. Daniel Bouton : Nous avons décidé de traiter cette affaire de manière totalement transparente. Autrement dit, sur le site Société Générale, vous avez accès à la totalité des constatations des inspections en cours. Un comité d’administrateurs indépendant a été créé spécialement pour la circonstance, présidé par M. Jean-Martin Folz. Tout ce qui a été publié jusqu’à présent ne porte que sur les back offices. Parce que l’enquête de justice a priorité, nous n’avions pas le droit d’interroger la hiérarchie du trader en question. Je ne vais pas, en période d’enquête pénale, donner mon sentiment sur la façon dont a fonctionné la hiérarchie. Cela étant, je comprends votre angoisse devant les raisons de cette position dissimulée. Je me borne à dire deux choses.
La première, c’est que je m’intéresse moins à cette affaire que je ne me préoccupe de l’avenir. L’avenir de la Société Générale, c’est de savoir si notre business model est bon et s’il doit continuer. La réponse, ce sont les 5,5 milliards que nous ont confiés les actionnaires. Autrement, ç’aurait pu être un drame.
La deuxième : hier, je parlais médecine avec le Président Accoyer, et je lui ai indiqué que nous avions lancé un programme de recherche pour voir si la médecine du travail pouvait contribuer à détecter des comportements complètement anormaux, comme celui de ce fraudeur, qui a pris une position d’une dizaine de milliards. Des tas de programmes sont lancés pour éviter ce type de situation.
M. Jean-François Lamour : La Société Générale se porte bien, et nous en sommes très heureux. Mais ce qui s’est passé a eu un effet dévastateur dans l’opinion publique. Nous nous en sommes rendu compte sur le terrain, pendant la campagne électorale.
Nous avons questionné certains de vos anciens traders qui ont travaillé dans vos salles de marché. Un trader n’est pas seul, il a des voisins qui entendent ce qui se passe et qui peuvent se rendre compte qu’il prend des positions dévastatrices. Comment se fait-il que, même au milieu de ses collègues, ce trader ait pu se comporter ainsi, non pas une seule fois, mais à de multiples reprises, durant de longs mois ?
M. Frédéric Lefebvre : Depuis des semaines, les uns et les autres nous expliquent que nous avons le meilleur système de contrôle du monde. Vous aussi. Vous avez parlé d’investir dans la médecine. Comment allez-vous donc investir dans le contrôle interne ? Que pensez-vous aussi des propositions pour améliorer le contrôle externe ?
M. Daniel Bouton : Je suis désolé que certains de vos électeurs vous aient interrogé sur la Société Générale, mais permettez-moi de penser surtout à ceux qui ont vraiment souffert, c’est-à-dire aux 13 000 employés de la Société Générale qui sont au service des ses 4 millions de clients. Pendant cinq ou six jours, ils ont eu à expliquer que la banque allait bien, malgré ce que l’on entendait sur les marchés. Nous l’avons expliqué à nos collaborateurs, et nos collaborateurs à nos clients. Et nous n’avons pas perdu de clients. C’est cela qui est important pour le système bancaire français. L’avenir de la Société Générale – et son conseil d’administration s’en occupe, comme l’assemblée générale de ses actionnaires le fera le moment venu –, il semble bien qu’il soit devant elle, et non compromis par une quelconque fraude.
M. Jérôme Cahuzac : Maintiendrez-vous une stratégie en vertu de laquelle 47 ou 48 % des résultats proviennent des activités de marché ?
M. Daniel Bouton : Elles engagent 29 % des capitaux propres. J’espère que vous avez souscrit à l’augmentation de capital ! Nous continuons à diminuer la part des capitaux propres alloués à la BFI. Nous avons l’intention de passer de 29 à 25 % d’ici à trois ans. Je suis confus de ne pouvoir répondre à toutes les questions sur les conséquences économiques pour la Société Générale, mais je vous signale que, pendant cette période, nous avons pris le contrôle de la deuxième banque russe : nous avons désormais 700 agences dans un pays qui connaîtra l’une des croissances les plus fortes dans les prochaines années. Si une entreprise de votre circonscription veut se développer entre Krasnoïarsk et Iakoutsk, elle peut aller voir la Rosbank, filiale de la Société Générale, qui sera contrôlée par la Société Générale à compter du 1er juin. Voilà notre stratégie : se développer dans les pays émergents qui auront une croissance forte dans les prochaines années. Les actions Société Générale sont sur le marché : achetez-les, monsieur le député !
Non seulement nous investissons dans les métiers de contrôle mais le conseil d’administration du 13 avril délibérera sur un changement innovant de l’architecture de contrôle, pas seulement sur les effectifs.
Je ne parviens pas à m’expliquer clairement, mais la question n’est pas tant la détection de la fraude, compte tenu du talent de dissimulation de cet homme. Allez voir sur le site l’annexe 4 qui détaille les quelque soixante-dix contrôles auxquels il a échappé. Les contrôles existent. Ce qui nous manquait, mais que nous faisons manuellement depuis le 24 janvier, et que nous sommes en train d’industrialiser, c’est la transversalité des contrôles. Je suis allé moi-même le dire aux régulateurs de façon que toutes les banques qui ne la pratiquent pas s’y mettent le plus vite possible. Des contrôles dans tous les sens ne servent à rien si l’on ne peut pas se rendre compte qu’un fraudeur a annulé un trop grand nombre d’opérations. C’est la transversalité qui aurait permis de détecter les anomalies. Elle existe dorénavant et bon nombre de banques, où elle n’existait pas, sont en train de l’industrialiser elles aussi. Dans ce domaine, c’est comme dans la police, la technologie du contrôle fait des progrès à chaque fraude découverte. Nous apprenons chaque fois, mais je ne suis pas sûr qu’il faille augmenter les dépenses. En 2008, nous dépenserons probablement entre 50 et 100 millions pour améliorer le dispositif de contrôle uniquement dans cette salle de marché. Ce ne sont pas des problèmes d’effectif ou de budget, c’est une question de conception des systèmes de contrôle sur lesquels nous devons faire des progrès supplémentaires.
M. François Goulard : Vous êtes entré dans le vif du sujet avec l’intégration du contrôle, qui préoccupe tout le monde. Mais, au sein de la Fédération bancaire française, quels ont été les échanges pour éviter que votre expérience malheureuse ne se reproduise ailleurs ? Travaille-t-on chacun pour soi ou bien y a-t-il, sur un sujet aussi fondamental, des échanges très ouverts ?
Votre établissement est, selon vous, suffisamment capitalisé au regard des règles Bâle I et Bâle II. Le mode de calcul des ratios est une chose, le niveau des capitaux en est une autre. Dans un monde où les risques sont nombreux, des capitaux propres plus élevés ne constitueraient-ils pas une réponse à la crise ? Votre première décision n’a-t-elle d’ailleurs pas été de rechercher de nouveaux capitaux ? Les capitaux propres sont bien le gage de la sécurité.
En ce qui concerne la restriction des crédits immobiliers et du financement des PME, vous nous avez dit qu’un bon dossier reste un bon dossier. Soit, mais pouvez-vous contester qu’il y ait un effet réseau ? Vous ne prenez pas toutes les décisions vous-même. Et vos milliers de collaborateurs peuvent être tentés, après un épisode difficile, d’être plus restrictifs. Quand la conjoncture est difficile, ils deviennent plus frileux. Pouvez-vous mesurer cet impact dans une banque de la taille de la vôtre ?
M. Daniel Bouton : Ce n’est certes pas moi qui décide, mais, tant qu’il y aura localement neuf établissements, le niveau de concurrence en France sera tel que, si aucun ne veut prêter de sous, c’est que le dossier présente un défaut quelque part. Si le marché était un monopole ou un duopole, vous auriez raison. Mais avec neuf offres presque partout en France, il ne peut y avoir ni contingentement ni credit crunch.
Mme Ariane Obolensky : Au sein de la Fédération française bancaire, il existe une commission particulière, la commission prudentielle, qui est présidée par un « chef de maison », c’est-à-dire un président de banque, pour en marquer la très grande importance. Cette commission rassemble seize personnes, qui sont les responsables de la surveillance prudentielle dans les établissements, et elle se réunit tous les mois. Il va de soi qu’elle a discuté des récents événements comme elle le fait des problèmes de supervision et de contrôle interne. C’est elle qui essaie de fixer la doctrine de la Fédération, avant qu’elle soit ensuite examinée par notre comité exécutif.
Nous avons des contacts très réguliers avec la Commission bancaire, tant au niveau technique – en dessous de moi ou avec moi – que politique – notamment avec le sous-gouverneur de la Banque de France compétent, avec lequel les sujets sont fréquemment abordés en termes généraux.
Autant nous pouvons discuter des textes, des problèmes, autant une commission ne peut pas – elle n’en a pas les moyens – descendre dans le concret. Il y a par définition des problèmes qui ne peuvent être traités qu’en interne, au vu de l’organisation propre à chaque établissement. Il peut y avoir un échange d’expériences, il ne peut pas y avoir substitution au travail qui est mené à l’intérieur des établissements. Enfin, dans certaines activités, les dispositifs de contrôle des risques font partie de la concurrence entre les banques, et de la sécurité qu’elles offrent. Il y a des choses qui ne peuvent pas s’échanger. Cela étant, je peux vous assurer que les questions de supervision et de contrôle sont vues très régulièrement par la Fédération bancaire française.
M. Jean-Pierre Brard : Monsieur le président, vous êtes fort habile et on a beaucoup de mal à obtenir des réponses précises. (René: le gangster BRARD était venu à TAHITI il y a peu: rien sur les XPF...)

Les banques françaises sont connues de tout le monde pour deux caractéristiques. La première est la bonne qualité des services rendus. Je parle pour mes concurrents comme pour la Société Générale, même si je pense que la Société Générale est « plus meilleure ». La seconde est la tarification, qui est très basse pour les crédits, et qui, pour les services, se situe dans la moyenne européenne. Toutes les enquêtes européennes montrent que c’est en France que l’on finance son logement le moins cher et que les paniers de services, qu’ils soient publiés par la Commission européenne ou par les organismes de consommateurs, nous placent à peu près dans la moyenne européenne. Comme je ne critique jamais tel ou tel de mes concurrents qui annonce un profit warning, j’ai le plaisir d’indiquer que la solidité des banques françaises est telle qu’elles sont capables d’encaisser et de résister dans un monde dans lequel le prix des maisons continuerait à baisser. C’est le métier des banques que de prendre en charge le coût du risque, qui est plus élevé quand le cycle est mauvais que quand il est bon. Ne vous inquiétez pas.
Le Rapporteur général : Cela veut-il dire que quand on vit dangereusement, on fait davantage de profit ?
M. Daniel Bouton : Il est sûr que la banque qui ne prête jamais d’argent n’existe pas et qu’en tout état de cause, elle ne gagne rien. La seule banque qui ne courrait pas de risque, ce serait une banque privée qui utiliserait l’argent de ses clients uniquement pour acheter des bons du Trésor de l’État français.
M. Henri Emmanuelli : Dexia ?
M. Daniel Bouton : En France, vous le savez, une collectivité locale du Poitou a connu des difficultés considérables !
Le Président Didier Migaud : C’est peu de chose !
M. Daniel Bouton : Nous mesurons le risque de défaillance des collectivités locales. D’ailleurs, elles demandent des ratings. Par ailleurs, heureusement que nous avons des clients qui présentent des risques extrêmement faibles !
M. Henri Emmanuelli : J’ai parlé de Dexia, pas de la Société Générale.
M. Daniel Bouton : Mais nous avons des prêts aux collectivités locales ! J’espère que vous n’imaginez pas qu’il puisse y avoir un monopole dans une quelconque activité bancaire : les caisses d’épargne, la Société Générale ou Dexia sont sur ce créneau.
Le Rapporteur général : Une précision à propos de la rentabilité de la Société Générale, supérieure à celle de ses concurrents. Cette banque a également subi un risque exceptionnel. Sans établir de relation entre les deux…
M. Daniel Bouton : Non ! Aucun rapport. Il y a eu fraude !
Le Rapporteur général : on sent bien que plus de risque entraîne plus de rentabilité, mais que plus de risque peut aussi provoquer plus de pépins.
M. Daniel Bouton : Tout le monde le sait, la banque de financement et d’investissement – la BFI – représente 29 % des capitaux propres à la Société Générale, contre 36 %, je crois, chez BNP-Paribas, notre plus grand concurrent. Il faut l’avoir à l’esprit. Nous avons atteint en fin de cycle, sur 2005-2006-2007, des niveaux de rentabilité qui ne sont pas récurrents. Tout le monde en est conscient sur le marché. La Société Générale, ou la BNP, aurait été valorisée trois fois son prix d’aujourd’hui si elle avait eu une BFI dégageant des résultats comme au sommet du cycle. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est normal que, quand un secteur économique va bien, les profits soient plus élevés et que, quand la conjoncture va un peu moins bien, les profits soient un peu plus bas. Les banques françaises, malgré la crise actuelle, sont en situation de gagner des milliards d’euros cumulés en 2008. Je suis très heureux d’être ici en train de me faire enguirlander parce que les profits anticipés des banques françaises en 2008 vous semblent un peu faibles, monsieur le Rapporteur général…
Le Président Didier Migaud : Une question n’a pas encore abordée, celle de la fraude ou des actions dissimulées. Comment cette dissimulation a-t-elle pu durer aussi longtemps et prendre pareille importance ? On a lu ici ou là que ne pas prendre de vacances pouvait paraître suspect. Pourquoi les contrôles opérés n’ont-ils pas eu de suite ? On a lu aussi que, tant que ce trader faisait gagner de l’argent, on n’était pas regardant, et que la question ne s’était posée qu’à partir du moment où certains seuils avaient été dépassés. Ce sont des questions que tout le monde se pose et, honnêtement, nous ne sommes pas entièrement convaincus par les réponses qui nous sont apportées.
M. Daniel Bouton : Puis-je suggérer à la représentation nationale de bien vouloir lire non pas ce qui a été écrit en qualité de roman dans tel ou tel journal…
M. Jean-François Lamour : Nous ne lisons pas que des romans !
M. Daniel Bouton : Nous avons décidé de traiter cette affaire de manière totalement transparente. Autrement dit, sur le site Société Générale, vous avez accès à la totalité des constatations des inspections en cours. Un comité d’administrateurs indépendant a été créé spécialement pour la circonstance, présidé par M. Jean-Martin Folz. Tout ce qui a été publié jusqu’à présent ne porte que sur les back offices. Parce que l’enquête de justice a priorité, nous n’avions pas le droit d’interroger la hiérarchie du trader en question. Je ne vais pas, en période d’enquête pénale, donner mon sentiment sur la façon dont a fonctionné la hiérarchie. Cela étant, je comprends votre angoisse devant les raisons de cette position dissimulée. Je me borne à dire deux choses.
La première, c’est que je m’intéresse moins à cette affaire que je ne me préoccupe de l’avenir. L’avenir de la Société Générale, c’est de savoir si notre business model est bon et s’il doit continuer. La réponse, ce sont les 5,5 milliards que nous ont confiés les actionnaires. Autrement, ç’aurait pu être un drame.
La deuxième : hier, je parlais médecine avec le Président Accoyer, et je lui ai indiqué que nous avions lancé un programme de recherche pour voir si la médecine du travail pouvait contribuer à détecter des comportements complètement anormaux, comme celui de ce fraudeur, qui a pris une position d’une dizaine de milliards. Des tas de programmes sont lancés pour éviter ce type de situation.
M. Jean-François Lamour : La Société Générale se porte bien, et nous en sommes très heureux. Mais ce qui s’est passé a eu un effet dévastateur dans l’opinion publique. Nous nous en sommes rendu compte sur le terrain, pendant la campagne électorale.
Nous avons questionné certains de vos anciens traders qui ont travaillé dans vos salles de marché. Un trader n’est pas seul, il a des voisins qui entendent ce qui se passe et qui peuvent se rendre compte qu’il prend des positions dévastatrices. Comment se fait-il que, même au milieu de ses collègues, ce trader ait pu se comporter ainsi, non pas une seule fois, mais à de multiples reprises, durant de longs mois ?
M. Frédéric Lefebvre : Depuis des semaines, les uns et les autres nous expliquent que nous avons le meilleur système de contrôle du monde. Vous aussi. Vous avez parlé d’investir dans la médecine. Comment allez-vous donc investir dans le contrôle interne ? Que pensez-vous aussi des propositions pour améliorer le contrôle externe ?
M. Daniel Bouton : Je suis désolé que certains de vos électeurs vous aient interrogé sur la Société Générale, mais permettez-moi de penser surtout à ceux qui ont vraiment souffert, c’est-à-dire aux 13 000 employés de la Société Générale qui sont au service des ses 4 millions de clients. Pendant cinq ou six jours, ils ont eu à expliquer que la banque allait bien, malgré ce que l’on entendait sur les marchés. Nous l’avons expliqué à nos collaborateurs, et nos collaborateurs à nos clients. Et nous n’avons pas perdu de clients. C’est cela qui est important pour le système bancaire français. L’avenir de la Société Générale – et son conseil d’administration s’en occupe, comme l’assemblée générale de ses actionnaires le fera le moment venu –, il semble bien qu’il soit devant elle, et non compromis par une quelconque fraude.
M. Jérôme Cahuzac : Maintiendrez-vous une stratégie en vertu de laquelle 47 ou 48 % des résultats proviennent des activités de marché ?
M. Daniel Bouton : Elles engagent 29 % des capitaux propres. J’espère que vous avez souscrit à l’augmentation de capital ! Nous continuons à diminuer la part des capitaux propres alloués à la BFI. Nous avons l’intention de passer de 29 à 25 % d’ici à trois ans. Je suis confus de ne pouvoir répondre à toutes les questions sur les conséquences économiques pour la Société Générale, mais je vous signale que, pendant cette période, nous avons pris le contrôle de la deuxième banque russe : nous avons désormais 700 agences dans un pays qui connaîtra l’une des croissances les plus fortes dans les prochaines années. Si une entreprise de votre circonscription veut se développer entre Krasnoïarsk et Iakoutsk, elle peut aller voir la Rosbank, filiale de la Société Générale, qui sera contrôlée par la Société Générale à compter du 1er juin. Voilà notre stratégie : se développer dans les pays émergents qui auront une croissance forte dans les prochaines années. Les actions Société Générale sont sur le marché : achetez-les, monsieur le député !
Non seulement nous investissons dans les métiers de contrôle mais le conseil d’administration du 13 avril délibérera sur un changement innovant de l’architecture de contrôle, pas seulement sur les effectifs.
Je ne parviens pas à m’expliquer clairement, mais la question n’est pas tant la détection de la fraude, compte tenu du talent de dissimulation de cet homme. Allez voir sur le site l’annexe 4 qui détaille les quelque soixante-dix contrôles auxquels il a échappé. Les contrôles existent. Ce qui nous manquait, mais que nous faisons manuellement depuis le 24 janvier, et que nous sommes en train d’industrialiser, c’est la transversalité des contrôles. Je suis allé moi-même le dire aux régulateurs de façon que toutes les banques qui ne la pratiquent pas s’y mettent le plus vite possible. Des contrôles dans tous les sens ne servent à rien si l’on ne peut pas se rendre compte qu’un fraudeur a annulé un trop grand nombre d’opérations. C’est la transversalité qui aurait permis de détecter les anomalies. Elle existe dorénavant et bon nombre de banques, où elle n’existait pas, sont en train de l’industrialiser elles aussi. Dans ce domaine, c’est comme dans la police, la technologie du contrôle fait des progrès à chaque fraude découverte. Nous apprenons chaque fois, mais je ne suis pas sûr qu’il faille augmenter les dépenses. En 2008, nous dépenserons probablement entre 50 et 100 millions pour améliorer le dispositif de contrôle uniquement dans cette salle de marché. Ce ne sont pas des problèmes d’effectif ou de budget, c’est une question de conception des systèmes de contrôle sur lesquels nous devons faire des progrès supplémentaires.
M. François Goulard : Vous êtes entré dans le vif du sujet avec l’intégration du contrôle, qui préoccupe tout le monde. Mais, au sein de la Fédération bancaire française, quels ont été les échanges pour éviter que votre expérience malheureuse ne se reproduise ailleurs ? Travaille-t-on chacun pour soi ou bien y a-t-il, sur un sujet aussi fondamental, des échanges très ouverts ?
Votre établissement est, selon vous, suffisamment capitalisé au regard des règles Bâle I et Bâle II. Le mode de calcul des ratios est une chose, le niveau des capitaux en est une autre. Dans un monde où les risques sont nombreux, des capitaux propres plus élevés ne constitueraient-ils pas une réponse à la crise ? Votre première décision n’a-t-elle d’ailleurs pas été de rechercher de nouveaux capitaux ? Les capitaux propres sont bien le gage de la sécurité.
En ce qui concerne la restriction des crédits immobiliers et du financement des PME, vous nous avez dit qu’un bon dossier reste un bon dossier. Soit, mais pouvez-vous contester qu’il y ait un effet réseau ? Vous ne prenez pas toutes les décisions vous-même. Et vos milliers de collaborateurs peuvent être tentés, après un épisode difficile, d’être plus restrictifs. Quand la conjoncture est difficile, ils deviennent plus frileux. Pouvez-vous mesurer cet impact dans une banque de la taille de la vôtre ?
M. Daniel Bouton : Ce n’est certes pas moi qui décide, mais, tant qu’il y aura localement neuf établissements, le niveau de concurrence en France sera tel que, si aucun ne veut prêter de sous, c’est que le dossier présente un défaut quelque part. Si le marché était un monopole ou un duopole, vous auriez raison. Mais avec neuf offres presque partout en France, il ne peut y avoir ni contingentement ni credit crunch.
Mme Ariane Obolensky : Au sein de la Fédération française bancaire, il existe une commission particulière, la commission prudentielle, qui est présidée par un « chef de maison », c’est-à-dire un président de banque, pour en marquer la très grande importance. Cette commission rassemble seize personnes, qui sont les responsables de la surveillance prudentielle dans les établissements, et elle se réunit tous les mois. Il va de soi qu’elle a discuté des récents événements comme elle le fait des problèmes de supervision et de contrôle interne. C’est elle qui essaie de fixer la doctrine de la Fédération, avant qu’elle soit ensuite examinée par notre comité exécutif.
Nous avons des contacts très réguliers avec la Commission bancaire, tant au niveau technique – en dessous de moi ou avec moi – que politique – notamment avec le sous-gouverneur de la Banque de France compétent, avec lequel les sujets sont fréquemment abordés en termes généraux.
Autant nous pouvons discuter des textes, des problèmes, autant une commission ne peut pas – elle n’en a pas les moyens – descendre dans le concret. Il y a par définition des problèmes qui ne peuvent être traités qu’en interne, au vu de l’organisation propre à chaque établissement. Il peut y avoir un échange d’expériences, il ne peut pas y avoir substitution au travail qui est mené à l’intérieur des établissements. Enfin, dans certaines activités, les dispositifs de contrôle des risques font partie de la concurrence entre les banques, et de la sécurité qu’elles offrent. Il y a des choses qui ne peuvent pas s’échanger. Cela étant, je peux vous assurer que les questions de supervision et de contrôle sont vues très régulièrement par la Fédération bancaire française.
M. Jean-Pierre Brard : Monsieur le président, vous êtes fort habile et on a beaucoup de mal à obtenir des réponses précises. (René: le gangster BRARD était venu à TAHITI il y a peu: rien sur les XPF...)

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Selon vous, personne n’aurait vu arriver la crise américaine. Ce n’est pas tout à fait vrai. Notre ministre conseiller auprès de notre ambassade à Washington, a fait une conférence il y a trois ans, devant l’IFRI à Paris. Graphiques à l’appui, il avait décrit la situation et il avait prévu le krach pour 2008-2009. Il avait même évoqué 1929. Qu’il y ait beaucoup d’autisme
– pas seulement chez les banquiers, mais aussi au gouvernement – c’est une chose, mais le diagnostic avait été correctement posé.
La fraude dans les banques existe depuis toujours. D’ailleurs, l’affaire du Sentier n’est pas si vieille. En 2007, à la Société Générale, quelle était la part des activités de marché respectivement dans le chiffre d’affaires et dans les bénéfices ? Et comment a-t-elle évolué ces cinq dernières années ?
M. Kerviel – il faut bien le nommer, tout de même – opérait principalement, semble-t-il, en dehors des grands marchés organisés. Est-ce un choix de la Société Générale ? Jusqu’à quel niveau de la hiérarchie de l’opérateur avez-vous appliqué – ou allez-vous appliquer – des sanctions ? Ou bien persistez-vous à dire, malgré ce qui a été expliqué sur la promiscuité des opérateurs dans les salles de marché, que ce trader était seul en cause ?
Quel est le taux de rendement maximal qu’il vous semble possible d’obtenir actuellement avec les produits financiers ? Lesquels ? Quel est le rendement moyen des transactions dans la salle de marché ? Enfin, prévoyez-vous de nouvelles dépréciations d’actifs à la Société Générale dans le cadre de la crise des crédits immobiliers et de leurs produits dérivés ? Si oui, pour quels montants ? Si l’on en croit les propos tenus dans la Tribune d’hier par M. Éric Galiègue, des pertes énormes sont encore à venir : 100 milliards de dollars de perte ont été dégagés et il en resterait au moins autant à combler.
Pourriez-vous, monsieur le président, nous répondre avec précision, même au détriment de votre habileté ?
M. Daniel Bouton : Je ne suis pas particulièrement réputé pour mon habileté.
M. Jean-Pierre Brard : Votre modestie vous honore.
M. Daniel Bouton : La Société Générale est la première contrepartie du marché organisé Euronext au niveau européen. Nous sommes le premier client d’Euronext au niveau français et le deuxième ou troisième sur le marché de dérivés Eurex, devenu célèbre après ce que vous savez. Notre métier n’est pas un métier dans lequel nous faisons de la transaction marginale comme le desk sur lequel pouvait travailler le fraudeur. Ce qui n’a pas été bien compris, c’est que la position dissimulée qui a été prise a été construite à partir d’une activité simplissime et non pas d’une activité à laquelle se livrent les anciens élèves de l’école à laquelle on a fait allusion, et dont je ne suis pas issu. L’arbitrage est une activité vieille comme le monde. Rappelez-vous le temps du bimétallisme où certains achetaient de l’or et le déplaçaient pour l’échanger contre de l’argent. C’était de l’arbitrage. Ce trader faisait la même chose. Il n’y a pas besoin d’être sorti de Princeton pour faire une activité dont la profitabilité, qui plus est, est extrêmement faible. Ce qu’il a fait n’a aucun rapport avec son activité normale.
Ce n’est pas le lieu de débattre des responsabilités, mais il a été annoncé dès le premier jour que le patron mondial des dérivés actions et celui des ressources allaient quitter la Société Générale. Les procédures françaises ne sont pas celles des États-Unis où ils auraient fait leur valise le jour même après s’être fait confisquer leur micro-ordinateur.
M. Jean-Pierre Brard : Sont-ils partis avec un pactole ?
M. Daniel Bouton : Ils sont partis dans le respect du droit du travail, ce qui me paraît parfaitement normal.
Pour connaître le taux de rendement moyen que l’on peut attendre d’un produit financier, allez dans une agence de la Société Générale qui vous proposera des produits différents avec des risques différents, et des rendements différents. Si vous avez un voisin qui veut à la fois un bon rendement et une garantie du capital, il faut qu’il aille dans une agence de banque française car, maintenant, nous avons été imités. Un produit garanti, par exemple indexé sur les actions, pour en avoir les avantages tout en en évitant les risques, se fabrique dans les tours de la Défense, de la Société Générale ou de Calyon, là où l’on sait mettre au point des produits structurés, garantis et sophistiqués. On peut ainsi jouer le rebond à cinq ans des marchés actions tout en étant sûr de ne pas perdre son capital ou d’en récupérer 90 %. C’est au client de déterminer le risque qu’il accepte.
Un progrès considérable a été fait grâce à la transposition d’une directive européenne, dite MiFID, entrée en application au mois d’octobre. Elle permet de vérifier que le banquier de base diffuse bien au consommateur toute l’information sur le risque qu’il prend en achetant tel ou tel produit financier. Vous savez bien qu’à l’exception de la dette de l’État français, tout papier comporte un risque.
Le Président Didier Migaud : Et l’hypothèse d’une nouvelle dépréciation ?
M. Daniel Bouton : J’ai répondu à M. Goulard.
M. Charles de Courson : En cas de très forte baisse des prix de l’immobilier, notamment aux États-unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, peut-il y avoir un risque systémique affectant les grandes banques internationales ?
La baisse, très forte, des taux directeurs décidée par la Banque centrale américaine et, dans une moindre mesure, par la Banque centrale européenne va-t-elle entraîner une baisse des taux effectivement pratiqués par les banques auprès des particuliers et des entreprises dans les mois qui viennent ?
M. Daniel Bouton : La France est un cas un peu particulier, s’agissant du marché du financement de l’immobilier, parce que, pour des raisons historiques et culturelles, nous sommes le pays au monde où les ménages se financent le plus avec des taux fixes. Pour acheter une maison, vous trouvez des crédits à quinze, dix-huit ou vingt ans, presque exclusivement à taux fixe. Ces taux dépendent de celui du marché, mais ils ne varient pas durant la vie du prêt, comme en Grande-Bretagne ou en Espagne. En ce qui nous concerne, nous appliquons les contrats, c’est-à-dire que le taux continue de s’appliquer pour les contrats en cours. Quant aux nouveaux, si le prix de l’argent monte, ceux des prêts immobiliers aussi, et, s’il baisse – je ne parle pas uniquement des taux courts, puisque nous prêtons à quinze ou vingt ans – les taux des crédits aussi. Nous répercutons le coût de la ressource dans le prix auquel nous vendons notre carburant, qui est l’argent. Les banques répercutent également sur les crédits à la consommation ou aux petites et moyennes entreprises. Nous devons emprunter de la ressource sur les marchés, nous répercutons ensuite sur les prix.
M. Charles de Courson : Une étude récente montrait que les taux d’intérêt ne baissent pas sensiblement.
M. Daniel Bouton : Le taux de l’argent en Europe n’a pas baissé, il a augmenté !
M. Charles de Courson : Aux États-unis, il a beaucoup baissé.
M. Daniel Bouton : Aux États-Unis, les taux d’intérêt sont en train de baisser considérablement dans l’économie réelle, pour l’emprunteur, celui qui achète la voiture ou la maison. Malheureusement, cela n’a pas l’air de suffire à tenir la consommation des ménages. C’est tout le problème.
M. Charles de Courson : Pensez-vous pouvoir maintenir votre taux de marge ?
M. Daniel Bouton : Je me suis fait enguirlander il y a cinq minutes, parce que l’on ne gagnait pas suffisamment de sous ! Je dirai que vous êtes l’auteur de la suggestion, monsieur de Courson !
Pour en revenir à la première question sur le risque systémique, je vous rappelle les deux dernières crises bancaires de cette nature : celle au Japon en 1991, dont je pense qu’il n’est toujours pas sorti et, en 1990, le collapsus du système bancaire suédois, d’une telle gravité qu’il a entraîné près de dix ans de stagnation. Les systèmes de régulation sont tels que la probabilité d’un risque systémique dans un des pays que vous avez cités est extraordinairement faible. Les grandes banques espagnoles, que je connais bien, je ne parle pas des petites, sont extrêmement bien capitalisées. Le milliard de profit de la Générale en 2007 le prouve bien, malgré tout ce dont on a parlé : nous avons tous – que ce soit nous, BNP-Paribas ou Calyon – une taille, une solidité, une profitabilité dans nos métiers telles qu’elles suffisent largement pour traverser des temps difficiles.
J’en profite pour compléter une de mes réponses. Faut-il augmenter le ratio de tier one, le ratio de fonds propres des banques ? C’est une question qui concerne fondamentalement les politiques et les régulateurs. J’y suis, en ce qui me concerne, complètement opposé pour une raison de « pro-cyclicité ». Dans le prochain cycle, quand tout ira bien dans l’économie, on pourra prendre la précaution d’augmenter les fonds propres pour la phase suivante – c’est aux régulateurs d’en décider. Il paraît d’ailleurs que la Société Générale a lancé en France la mode du 8 % de ratio de fonds propres obtenus par augmentation de capital. Mais, en creux de cycle, si j’étais le régulateur, ce que je ne suis pas, j’accepterais, pour des raisons de soutien à l’économie, que les ratios de tier one descendent. C’est un problème de Bâle II, connu uniquement des amateurs : la réglementation est intrinsèquement pro-cyclique et c’est, à mon avis, dangereux.
M. Charles de Courson : Votre réponse sur la solidité des banques ne vaut que pour la France, ce n’est pas forcément vrai aux États-Unis.
M. Daniel Bouton : Il s’est passé plusieurs choses extrêmement importantes ces trois dernières semaines. Il s’est avéré que Bear Stearns, la cinquième banque d’investissement américaine, pouvait être une catastrophe pour ses actionnaires mais qu’elle pouvait aussi, avec l’aide de la Fed, trouver une solution qui évite tout risque systémique. Ensuite, la grande banque UBS, qui a perdu énormément d’argent sur le marché immobilier aux États-Unis, a trouvé sur le marché une solution pour se recapitaliser, comme la Société Générale en janvier, bien que les causes aient été différentes. Lehman Brothers ont fait de même, alors que certains disaient, comme d’habitude, qu’ils pouvaient aller mal. Au cours des trois dernières semaines, la démonstration a été faite que, même avec des établissements spécialisés comme aux États-Unis, la probabilité d’une crise systémique était extraordinairement faible, voire nulle. Je fais partie non pas des optimistes sur la situation actuelle du marché du crédit et de la liquidité, mais de ceux qui pensent que la situation a commencé à s’améliorer.
M. Jean-François Lamour : Vous prenez la décision de déboucler les positions le dimanche après-midi. Christian Noyer, qui avait été informé, nous l’a confirmé. Or vous débouclez le lundi, jour où la bourse de New York était fermée, si bien que vous faites porter sur les marchés asiatique et européen une grosse partie des opérations,…
M. Daniel Bouton : Zéro sur les marchés asiatiques puisque la position dissimulée était entièrement européenne !
M. Jean-François Lamour :…avec un impact possible sur le marché asiatique, et, par la suite, une baisse de trois-quarts de point des taux américains après un vent de panique. Confirmez-vous ou infirmez-vous ce diagnostic ?

– pas seulement chez les banquiers, mais aussi au gouvernement – c’est une chose, mais le diagnostic avait été correctement posé.
La fraude dans les banques existe depuis toujours. D’ailleurs, l’affaire du Sentier n’est pas si vieille. En 2007, à la Société Générale, quelle était la part des activités de marché respectivement dans le chiffre d’affaires et dans les bénéfices ? Et comment a-t-elle évolué ces cinq dernières années ?
M. Kerviel – il faut bien le nommer, tout de même – opérait principalement, semble-t-il, en dehors des grands marchés organisés. Est-ce un choix de la Société Générale ? Jusqu’à quel niveau de la hiérarchie de l’opérateur avez-vous appliqué – ou allez-vous appliquer – des sanctions ? Ou bien persistez-vous à dire, malgré ce qui a été expliqué sur la promiscuité des opérateurs dans les salles de marché, que ce trader était seul en cause ?
Quel est le taux de rendement maximal qu’il vous semble possible d’obtenir actuellement avec les produits financiers ? Lesquels ? Quel est le rendement moyen des transactions dans la salle de marché ? Enfin, prévoyez-vous de nouvelles dépréciations d’actifs à la Société Générale dans le cadre de la crise des crédits immobiliers et de leurs produits dérivés ? Si oui, pour quels montants ? Si l’on en croit les propos tenus dans la Tribune d’hier par M. Éric Galiègue, des pertes énormes sont encore à venir : 100 milliards de dollars de perte ont été dégagés et il en resterait au moins autant à combler.
Pourriez-vous, monsieur le président, nous répondre avec précision, même au détriment de votre habileté ?
M. Daniel Bouton : Je ne suis pas particulièrement réputé pour mon habileté.
M. Jean-Pierre Brard : Votre modestie vous honore.
M. Daniel Bouton : La Société Générale est la première contrepartie du marché organisé Euronext au niveau européen. Nous sommes le premier client d’Euronext au niveau français et le deuxième ou troisième sur le marché de dérivés Eurex, devenu célèbre après ce que vous savez. Notre métier n’est pas un métier dans lequel nous faisons de la transaction marginale comme le desk sur lequel pouvait travailler le fraudeur. Ce qui n’a pas été bien compris, c’est que la position dissimulée qui a été prise a été construite à partir d’une activité simplissime et non pas d’une activité à laquelle se livrent les anciens élèves de l’école à laquelle on a fait allusion, et dont je ne suis pas issu. L’arbitrage est une activité vieille comme le monde. Rappelez-vous le temps du bimétallisme où certains achetaient de l’or et le déplaçaient pour l’échanger contre de l’argent. C’était de l’arbitrage. Ce trader faisait la même chose. Il n’y a pas besoin d’être sorti de Princeton pour faire une activité dont la profitabilité, qui plus est, est extrêmement faible. Ce qu’il a fait n’a aucun rapport avec son activité normale.
Ce n’est pas le lieu de débattre des responsabilités, mais il a été annoncé dès le premier jour que le patron mondial des dérivés actions et celui des ressources allaient quitter la Société Générale. Les procédures françaises ne sont pas celles des États-Unis où ils auraient fait leur valise le jour même après s’être fait confisquer leur micro-ordinateur.
M. Jean-Pierre Brard : Sont-ils partis avec un pactole ?
M. Daniel Bouton : Ils sont partis dans le respect du droit du travail, ce qui me paraît parfaitement normal.
Pour connaître le taux de rendement moyen que l’on peut attendre d’un produit financier, allez dans une agence de la Société Générale qui vous proposera des produits différents avec des risques différents, et des rendements différents. Si vous avez un voisin qui veut à la fois un bon rendement et une garantie du capital, il faut qu’il aille dans une agence de banque française car, maintenant, nous avons été imités. Un produit garanti, par exemple indexé sur les actions, pour en avoir les avantages tout en en évitant les risques, se fabrique dans les tours de la Défense, de la Société Générale ou de Calyon, là où l’on sait mettre au point des produits structurés, garantis et sophistiqués. On peut ainsi jouer le rebond à cinq ans des marchés actions tout en étant sûr de ne pas perdre son capital ou d’en récupérer 90 %. C’est au client de déterminer le risque qu’il accepte.
Un progrès considérable a été fait grâce à la transposition d’une directive européenne, dite MiFID, entrée en application au mois d’octobre. Elle permet de vérifier que le banquier de base diffuse bien au consommateur toute l’information sur le risque qu’il prend en achetant tel ou tel produit financier. Vous savez bien qu’à l’exception de la dette de l’État français, tout papier comporte un risque.
Le Président Didier Migaud : Et l’hypothèse d’une nouvelle dépréciation ?
M. Daniel Bouton : J’ai répondu à M. Goulard.
M. Charles de Courson : En cas de très forte baisse des prix de l’immobilier, notamment aux États-unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, peut-il y avoir un risque systémique affectant les grandes banques internationales ?
La baisse, très forte, des taux directeurs décidée par la Banque centrale américaine et, dans une moindre mesure, par la Banque centrale européenne va-t-elle entraîner une baisse des taux effectivement pratiqués par les banques auprès des particuliers et des entreprises dans les mois qui viennent ?
M. Daniel Bouton : La France est un cas un peu particulier, s’agissant du marché du financement de l’immobilier, parce que, pour des raisons historiques et culturelles, nous sommes le pays au monde où les ménages se financent le plus avec des taux fixes. Pour acheter une maison, vous trouvez des crédits à quinze, dix-huit ou vingt ans, presque exclusivement à taux fixe. Ces taux dépendent de celui du marché, mais ils ne varient pas durant la vie du prêt, comme en Grande-Bretagne ou en Espagne. En ce qui nous concerne, nous appliquons les contrats, c’est-à-dire que le taux continue de s’appliquer pour les contrats en cours. Quant aux nouveaux, si le prix de l’argent monte, ceux des prêts immobiliers aussi, et, s’il baisse – je ne parle pas uniquement des taux courts, puisque nous prêtons à quinze ou vingt ans – les taux des crédits aussi. Nous répercutons le coût de la ressource dans le prix auquel nous vendons notre carburant, qui est l’argent. Les banques répercutent également sur les crédits à la consommation ou aux petites et moyennes entreprises. Nous devons emprunter de la ressource sur les marchés, nous répercutons ensuite sur les prix.
M. Charles de Courson : Une étude récente montrait que les taux d’intérêt ne baissent pas sensiblement.
M. Daniel Bouton : Le taux de l’argent en Europe n’a pas baissé, il a augmenté !
M. Charles de Courson : Aux États-unis, il a beaucoup baissé.
M. Daniel Bouton : Aux États-Unis, les taux d’intérêt sont en train de baisser considérablement dans l’économie réelle, pour l’emprunteur, celui qui achète la voiture ou la maison. Malheureusement, cela n’a pas l’air de suffire à tenir la consommation des ménages. C’est tout le problème.
M. Charles de Courson : Pensez-vous pouvoir maintenir votre taux de marge ?
M. Daniel Bouton : Je me suis fait enguirlander il y a cinq minutes, parce que l’on ne gagnait pas suffisamment de sous ! Je dirai que vous êtes l’auteur de la suggestion, monsieur de Courson !
Pour en revenir à la première question sur le risque systémique, je vous rappelle les deux dernières crises bancaires de cette nature : celle au Japon en 1991, dont je pense qu’il n’est toujours pas sorti et, en 1990, le collapsus du système bancaire suédois, d’une telle gravité qu’il a entraîné près de dix ans de stagnation. Les systèmes de régulation sont tels que la probabilité d’un risque systémique dans un des pays que vous avez cités est extraordinairement faible. Les grandes banques espagnoles, que je connais bien, je ne parle pas des petites, sont extrêmement bien capitalisées. Le milliard de profit de la Générale en 2007 le prouve bien, malgré tout ce dont on a parlé : nous avons tous – que ce soit nous, BNP-Paribas ou Calyon – une taille, une solidité, une profitabilité dans nos métiers telles qu’elles suffisent largement pour traverser des temps difficiles.
J’en profite pour compléter une de mes réponses. Faut-il augmenter le ratio de tier one, le ratio de fonds propres des banques ? C’est une question qui concerne fondamentalement les politiques et les régulateurs. J’y suis, en ce qui me concerne, complètement opposé pour une raison de « pro-cyclicité ». Dans le prochain cycle, quand tout ira bien dans l’économie, on pourra prendre la précaution d’augmenter les fonds propres pour la phase suivante – c’est aux régulateurs d’en décider. Il paraît d’ailleurs que la Société Générale a lancé en France la mode du 8 % de ratio de fonds propres obtenus par augmentation de capital. Mais, en creux de cycle, si j’étais le régulateur, ce que je ne suis pas, j’accepterais, pour des raisons de soutien à l’économie, que les ratios de tier one descendent. C’est un problème de Bâle II, connu uniquement des amateurs : la réglementation est intrinsèquement pro-cyclique et c’est, à mon avis, dangereux.
M. Charles de Courson : Votre réponse sur la solidité des banques ne vaut que pour la France, ce n’est pas forcément vrai aux États-Unis.
M. Daniel Bouton : Il s’est passé plusieurs choses extrêmement importantes ces trois dernières semaines. Il s’est avéré que Bear Stearns, la cinquième banque d’investissement américaine, pouvait être une catastrophe pour ses actionnaires mais qu’elle pouvait aussi, avec l’aide de la Fed, trouver une solution qui évite tout risque systémique. Ensuite, la grande banque UBS, qui a perdu énormément d’argent sur le marché immobilier aux États-Unis, a trouvé sur le marché une solution pour se recapitaliser, comme la Société Générale en janvier, bien que les causes aient été différentes. Lehman Brothers ont fait de même, alors que certains disaient, comme d’habitude, qu’ils pouvaient aller mal. Au cours des trois dernières semaines, la démonstration a été faite que, même avec des établissements spécialisés comme aux États-Unis, la probabilité d’une crise systémique était extraordinairement faible, voire nulle. Je fais partie non pas des optimistes sur la situation actuelle du marché du crédit et de la liquidité, mais de ceux qui pensent que la situation a commencé à s’améliorer.
M. Jean-François Lamour : Vous prenez la décision de déboucler les positions le dimanche après-midi. Christian Noyer, qui avait été informé, nous l’a confirmé. Or vous débouclez le lundi, jour où la bourse de New York était fermée, si bien que vous faites porter sur les marchés asiatique et européen une grosse partie des opérations,…
M. Daniel Bouton : Zéro sur les marchés asiatiques puisque la position dissimulée était entièrement européenne !
M. Jean-François Lamour :…avec un impact possible sur le marché asiatique, et, par la suite, une baisse de trois-quarts de point des taux américains après un vent de panique. Confirmez-vous ou infirmez-vous ce diagnostic ?

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Les sociétés de rating et les analystes financiers donnent par ailleurs l’impression de ne pas faire réellement leur travail. Quelles conséquences en avez-vous tirées pour l’avenir ? La titrisation est indispensable, selon vous, pour lever des fonds et développer votre activité, mais elle comporte des risques qui sont apparemment mal évalués. Avez-vous des propositions à faire dans ce domaine ?
M. Daniel Bouton : La Fédération bancaire française a répondu à cette question avec ma comparaison entre le pomerol et le côte de nuits. Nous suggérons que les agences de rating n’utilisent pas la même échelle pour des papiers structurés et pour des organismes vivants. C’est la première proposition, avant d’autres. Il y a un parallélisme des intérêts dans la mesure où, si les agences de rating ne rétablissent pas la crédibilité de la notation sur ces papiers, leur destin sera derrière elles. Nous ne pensons pas qu’une régulation de ces agences soit nécessaire. Leur survie est en jeu. L’IOSCO, organisme présidé par un Français, Michel Prada, en débattra en juin à Paris.
Je sais bien que la Société Générale est le centre du monde, que la France est le centre du monde ; mais, de là à ce que nous, acteurs microéconomiques, ayons une influence sur la politique de taux aux États-Unis… Le point a été réglé par le conseil des gouverneurs dans une conférence de presse.
Quant au débouclage, ce sont les autorités de supervision des marchés qui l’ont traité. Elles ont rendu compte du fait que nous avions donné instruction de déboucler dans le respect de l’intégrité des marchés. Ce qui a été fait puisque personne n’a rien vu le lundi et le mardi. Nous sommes supervisés par Euronext, Eurex et le Liffe, sur lequel le fraudeur avait aussi pris position, mais dans une faible mesure. Ils observent les transactions en permanence, avec des mécanismes électroniques extrêmement sophistiqués destinés à détecter les anomalies. M. Prada, comme Mme Lagarde, ont indiqué qu’ils n’avaient rien décelé. Le débouclage a donc été fait dans des conditions qui ont respecté l’intégrité des marchés. Je ne pense pas qu’il y ait débat sur ce point. Heureusement, nous n’avons pas tout vendu en une seule fois à 9 heures 12. C’eut été totalement impossible d’ailleurs.
M. Yves Censi : Je ne pense pas que l’on puisse ici entrer dans le détail des procédures internes et des systèmes d’exploitation qui relèvent de la responsabilité des décideurs que vous êtes. Je me méfie beaucoup des propositions débouchant sur des décisions réglementaires intempestives. À ce propos, souhaiteriez-vous avoir des relations différentes avec les autorités de contrôle ? En matière de contrôle interne, même si ce trader était affecté aux opérations d’arbitrage classique, avez-vous des propositions à faire pour améliorer les procédures ? Où fixer le risque que vous acceptez de prendre en charge ?
La financiarisation est utile à l’économie française et, selon vous, il n’existe pas de séparation entre la finance et l’économie. Oui et non : l’argent circule, il est le sang des entreprises, qui sont les organes de l’économie. Les turbulences boursières ne touchent pas directement l’économie réelle. Vous avez fait des propositions pour améliorer la régulation et la stabilité financière, en évoquant Bâle II, avec la prise en compte du hors-bilan.
M. Daniel Bouton : C’était avec Bâle I. Personne n’applique encore Bâle II.
M. Yves Censi : En ce qui concerne l’articulation entre crise financière et crise économique, ne faudrait-il pas favoriser l’épargne longue et l’orienter vers les financements et le marché primaire ? Ne faut-il pas réfléchir à une rémunération en fonction du risque et de la durée de placement ?
M. Daniel Bouton : Sur ce dernier point, mes collègues et moi-même sommes à la disposition de votre Commission pour contribuer à tous travaux de réflexion sur l’épargne longue. La France a un problème depuis fort longtemps, l’épargne ayant été absorbée pendant un moment par le financement du déficit budgétaire. Nous n’avons pas créé les fonds de pension qui auraient permis de ne pas toucher aux régimes de retraite, mais c’est un autre sujet. Si vous voulez que je revienne, moi ou un autre de mes collègues, vous aurez la même analyse.
Vous avez tout à fait raison de dire que Bâle II change tout par rapport à Bâle I. Par exemple, le risque de fraude correspond, dans notre réglementation, au risque opérationnel. Il est pris en charge dans Bâle II et toutes les banques auront à constituer un coussin de capital pour parer à l’éventualité du risque opérationnel. Le système Bâle II est intrinsèquement meilleur.
Vous avez aussi raison de souligner l’importance très grande des calculs de probabilité. Dans notre cas précis, la probabilité est la combinaison de trois risques. Quelle est la probabilité pour qu’il y ait un fraudeur non détecté ? Quelle est la probabilité, une fois qu’il est découvert, que la position dissimulée soit petite, moyenne ou grosse, sachant qu’un fraudeur est par définition susceptible de faire n’importe quoi ? Enfin, quelle est la probabilité que le débouclage, dont nous avons parlé, intervienne dans des conditions de marché aussi dégueulasses, si je puis me permettre d’être vulgaire, que celles qui ont été décrites ? Eh bien, les calculs montrent que, par chance, si j’ose dire, même dans un système dans lequel il y aurait un fraudeur qui aurait une très grosse position, la probabilité, dans une banque autre que la Société Générale – puisque, heureusement, le risque y est désormais encore plus faible compte tenu de ce que nous avons fait – que l’opération coûte aussi cher que chez nous est infinitésimale. Le résultat est la conjonction de la fraude, de l’importance de la position du fraudeur, et du fait que les marchés asiatiques avaient commencé à dégouliner le matin même, dans le sillage de New York et de Paris qui avaient plongé le vendredi midi. Là on n’y peut vraiment rien. Parler en termes de probabilité est horrible puisque nous devrions nous rapprocher du « zéro défaut », j’en conviens. Mais la bonne nouvelle, c’est que la probabilité statistique d’un événement aussi lourd de conséquence est minime. Pourtant, il s’est réalisé. Mais, dans le même temps, les marchés financiers sont tels que nous avons réalisé dans la foulée une augmentation de capital qui a été sursouscrite. Si les marchés avaient cru nos systèmes vérolés et pourris, c’en était terminé. Normalement, 7 % environ du capital sont dans les mains d’actionnaires individuels français. Nous avons donc eu affaire à des investisseurs hyperprofessionnels, que ce soit le fonds de réserve des retraites de Paris ou du Milwaukee. Il a donc fallu leur expliquer pourquoi nous n’avions gagné qu’un milliard, au lieu de cinq. Il n’y a pas que la fraude qui les intéresse, il y a aussi l’économie américaine, l’exposition au risque, et surtout le business plan pour 2010 ; bref, la vision à moyen terme. Et nous avons placé notre augmentation de capital avec un assez grand succès.
M. Louis Giscard d’Estaing : La titrisation permet la dissémination du risque. Pour avoir une meilleure traçabilité, par exemple pour détecter un arrière-goût de subprime dans un produit structuré, ne faudrait-il pas plutôt faire appel à un œnologue qu’à un polytechnicien ?
M. Daniel Bouton : La traçabilité n’est pas parfaite dans la réglementation française, l’INAO 1937 modifié. Non, il n’est pas obligatoire en France, contrairement à la réglementation européenne, de donner la composition par cépage de tout produit au-delà des VDQS. Je suis pour une réglementation qui permette de savoir ce qu’il y a dans un vin. En Bourgogne, c’est du pinot noir à 100 % ; dans le pomerol, vous savez qu’il y a du merlot, du cabernet sauvignon. Quelle était la question au fond ?
M. Michel Bouvard : Qui fait office de CNAOC pour les produits financiers ?
M. Daniel Bouton : Chez un grand producteur, on ne peut pas boire toutes les bouteilles de l’échantillon, mais il y a la marque, le producteur, le négociant. En fait, le contenu du produit figure déjà dans la documentation. Je l’ai regardée de près, puisque nous avons commis l’erreur d’avoir de tels produits. Il est mentionné le pourcentage de tel ou tel subprime, de telle ou telle origine, de telle ou telle qualité.
M. Michel Bouvard : Au premier niveau, mais vous savez bien que des investisseurs se sont retrouvés avec des subprimes pour avoir investi dans des produits d’une telle complexité qu’ils n’étaient plus immédiatement lisibles.
M. Daniel Bouton : Je ne suis pas d’accord. Ces produits ne se vendent jamais aux particuliers, ils ne s’adressent qu’aux super-professionnnels. Mais nous avons été victimes, comme d’autres, du mirage du rating. La documentation juridique existe, tout y est décrit. Mais si les investisseurs professionnels l’ont, les intermédiaires comme les banques, ou les investisseurs finaux ne l’ont pas lue. Ils ont alors découvert qu’un produit triple A pouvait se baser sur des subprimes. Je ne suis pas forcément contre. Il faut que les investisseurs lisent la documentation pour savoir ce qu’ils achètent. C’est fondamental. Cela étant, la mécanique du produit sophistiqué n’est pas morte. Les rapports en cours de rédaction pour les différents régulateurs le disent, il ne faut pas s’arrêter au rating, qui ne vaut que pour ce qu’il donne, à savoir la solvabilité. Il ne mesure pas la liquidité. Il faut aussi que chaque investisseur professionnel fasse son boulot et aille regarder en profondeur.
Le subprime n’est pas mauvais en soi, il a servi pendant trente ans de politique du logement aux États-Unis. Ils n’ont pas d’organismes subventionnés par le contribuable par le biais du monopole d’un produit défiscalisé qui sert à financer le logement social. Ils ont une catégorie de marché qui a permis de loger des millions de ménages désargentés. Ce n’est pas idiot d’autant que, le marché montant, ces ménages ont pu s’enrichir. Néanmoins, pour une raison qui n’est pas très claire à mes yeux, le système a dérapé de 2005 à 2007, dans la mesure où on ne regardait pas si les gens pouvaient payer en ne se référant qu’au ratio loan to value. Ce n’est pas le subprime qui est mort, c’est la queue de distribution de la fin de cycle qui est de très médiocre qualité.
M. Louis Giscard d’Estaing : Concernant la dépréciation et la fair market value, souhaitez-vous une évolution des normes IFRS ? Quelle est votre opinion sur les rehausseurs de crédit ? S’agissant d’un produit bancaire français défiscalisé, que pensez-vous de la banalisation et d’un commissionnement à 0,4 %, comme le recommande M. Camdessus ?
M. Daniel Bouton : Sur ce dernier point, la Fédération représente des intérêts contradictoires puisque la Caisse d’épargne et la Poste en sont membres. Je ne voudrais pas choquer quiconque. Les banques qui proposaient de banaliser le livret A suggéraient 0,80 %. M. Camdessus a écrit 0,40 %. Le rapport Camdessus montrait qu’il n’est plus optimal dans un monde « marchéisé », pour le financement du logement social, de passer par un monopole. Le Parlement et le Gouvernement feront ce qu’ils souhaitent.
La question des rehausseurs de crédit est liée à celles des collectivités locales. Dexia n’est pas seule en cause, il y a aussi les Caisses d’épargne et la Société Générale. Le métier de base des rehausseurs, c’est de permettre à une collectivité locale d’emprunter moins cher que ne le lui permettrait son rating intrinsèque. Une collectivité locale qui a fait des bêtises – aux États-Unis ou en France, c’est pareil – et qui présente une dette par habitant beaucoup trop élevée, paiera sa dette de plus en plus cher, au point parfois de compromettre ses investissements futurs, comme le renouvellement de son réseau d’assainissement. Le système qui existe aux États-Unis, mais, à ma connaissance, pas en France – on pourra y réfléchir – permet à la collectivité, moyennant une prime qu’elle verse à un assureur, de diviser le risque : le risque primaire, celui de la collectivité locale, et le risque contingent, pris en charge par l’assureur « monoline ». Cela permet à la collectivité locale d’emprunter beaucoup moins cher. C’est un métier parfaitement respectable même s’il n’existe pas, en France, pour les collectivités locales. Il vaut mieux que la qualité du risque intrinsèque reste suffisamment bonne, ce qui est le cas aujourd’hui pour l’immense majorité des collectivités locales. Ces dernières années, Calyon, BNP et la Société Générale ont dû passer des provisions car la situation financière de ces compagnies monoline s’est dégradée parce qu’elles vont être appelées en garantie des produits structurés. La bonne nouvelle, c’est que les trois plus grosses d’entre elles ont été recapitalisées : la filiale de Natixis par ses actionnaires, comme la seconde, CIFG, qui a pu conserver son rating, la troisième, Ambac, avec l’intervention d’un syndicat bancaire dans lequel figuraient des banques américaines et BNP-Paribas. La situation n’est pas forcément stabilisée, mais la crise des rehausseurs a franchi un cap.
M. Yves Deniau : Après la réussite de votre augmentation de capital, pensez-vous avoir écarté tout risque d’OPA ? On en a beaucoup parlé, et vous avez d’ailleurs été l’objet d’une tentative il y a neuf ans. À l’époque, vous disiez que 45 % du capital appartenaient à des fonds de pension étrangers et que l’indépendance avait pu être préservée grâce à l’actionnariat salarié, qui représentait alors 9 %. Qu’en est-il de la structure de votre actionnariat aujourd’hui ? Vous garantit-elle l’indépendance en cas d’OPA hostile ?
M. Daniel Bouton : Après une augmentation de capital comme celle-ci, nous faisons une enquête, mais je n’en connais pas encore le résultat qui sera diffusé autour du 15 avril.
Ce n’était pas une véritable tentative d’OPA. La Société Générale présente la particularité d’avoir été l’objet d’une tentative d’OPA rampante en juillet 1988. Vous vous rappelez Marceau Investissement, Georges Pébereau, Marc Viénot, qui avaient occupé l’actualité pendant un moment. Nous avons fait certes l’objet d’une OPA « de marché », comme il en existe normalement en système capitaliste, de la part de la BNP, puis de BNP-Paribas de Michel Pébereau. Nous sommes l’une des rares sociétés au monde à avoir tenu face à une tentative d’OPA rampante, soutenue par un État occidental, et une OPA classique et officielle. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas une troisième. Cela fait partie des règles du jeu. Simplement on connaît, par expérience.
Le Président Didier Migaud : Monsieur le président, madame la directrice générale, je vous remercie.

M. Daniel Bouton : La Fédération bancaire française a répondu à cette question avec ma comparaison entre le pomerol et le côte de nuits. Nous suggérons que les agences de rating n’utilisent pas la même échelle pour des papiers structurés et pour des organismes vivants. C’est la première proposition, avant d’autres. Il y a un parallélisme des intérêts dans la mesure où, si les agences de rating ne rétablissent pas la crédibilité de la notation sur ces papiers, leur destin sera derrière elles. Nous ne pensons pas qu’une régulation de ces agences soit nécessaire. Leur survie est en jeu. L’IOSCO, organisme présidé par un Français, Michel Prada, en débattra en juin à Paris.
Je sais bien que la Société Générale est le centre du monde, que la France est le centre du monde ; mais, de là à ce que nous, acteurs microéconomiques, ayons une influence sur la politique de taux aux États-Unis… Le point a été réglé par le conseil des gouverneurs dans une conférence de presse.
Quant au débouclage, ce sont les autorités de supervision des marchés qui l’ont traité. Elles ont rendu compte du fait que nous avions donné instruction de déboucler dans le respect de l’intégrité des marchés. Ce qui a été fait puisque personne n’a rien vu le lundi et le mardi. Nous sommes supervisés par Euronext, Eurex et le Liffe, sur lequel le fraudeur avait aussi pris position, mais dans une faible mesure. Ils observent les transactions en permanence, avec des mécanismes électroniques extrêmement sophistiqués destinés à détecter les anomalies. M. Prada, comme Mme Lagarde, ont indiqué qu’ils n’avaient rien décelé. Le débouclage a donc été fait dans des conditions qui ont respecté l’intégrité des marchés. Je ne pense pas qu’il y ait débat sur ce point. Heureusement, nous n’avons pas tout vendu en une seule fois à 9 heures 12. C’eut été totalement impossible d’ailleurs.
M. Yves Censi : Je ne pense pas que l’on puisse ici entrer dans le détail des procédures internes et des systèmes d’exploitation qui relèvent de la responsabilité des décideurs que vous êtes. Je me méfie beaucoup des propositions débouchant sur des décisions réglementaires intempestives. À ce propos, souhaiteriez-vous avoir des relations différentes avec les autorités de contrôle ? En matière de contrôle interne, même si ce trader était affecté aux opérations d’arbitrage classique, avez-vous des propositions à faire pour améliorer les procédures ? Où fixer le risque que vous acceptez de prendre en charge ?
La financiarisation est utile à l’économie française et, selon vous, il n’existe pas de séparation entre la finance et l’économie. Oui et non : l’argent circule, il est le sang des entreprises, qui sont les organes de l’économie. Les turbulences boursières ne touchent pas directement l’économie réelle. Vous avez fait des propositions pour améliorer la régulation et la stabilité financière, en évoquant Bâle II, avec la prise en compte du hors-bilan.
M. Daniel Bouton : C’était avec Bâle I. Personne n’applique encore Bâle II.
M. Yves Censi : En ce qui concerne l’articulation entre crise financière et crise économique, ne faudrait-il pas favoriser l’épargne longue et l’orienter vers les financements et le marché primaire ? Ne faut-il pas réfléchir à une rémunération en fonction du risque et de la durée de placement ?
M. Daniel Bouton : Sur ce dernier point, mes collègues et moi-même sommes à la disposition de votre Commission pour contribuer à tous travaux de réflexion sur l’épargne longue. La France a un problème depuis fort longtemps, l’épargne ayant été absorbée pendant un moment par le financement du déficit budgétaire. Nous n’avons pas créé les fonds de pension qui auraient permis de ne pas toucher aux régimes de retraite, mais c’est un autre sujet. Si vous voulez que je revienne, moi ou un autre de mes collègues, vous aurez la même analyse.
Vous avez tout à fait raison de dire que Bâle II change tout par rapport à Bâle I. Par exemple, le risque de fraude correspond, dans notre réglementation, au risque opérationnel. Il est pris en charge dans Bâle II et toutes les banques auront à constituer un coussin de capital pour parer à l’éventualité du risque opérationnel. Le système Bâle II est intrinsèquement meilleur.
Vous avez aussi raison de souligner l’importance très grande des calculs de probabilité. Dans notre cas précis, la probabilité est la combinaison de trois risques. Quelle est la probabilité pour qu’il y ait un fraudeur non détecté ? Quelle est la probabilité, une fois qu’il est découvert, que la position dissimulée soit petite, moyenne ou grosse, sachant qu’un fraudeur est par définition susceptible de faire n’importe quoi ? Enfin, quelle est la probabilité que le débouclage, dont nous avons parlé, intervienne dans des conditions de marché aussi dégueulasses, si je puis me permettre d’être vulgaire, que celles qui ont été décrites ? Eh bien, les calculs montrent que, par chance, si j’ose dire, même dans un système dans lequel il y aurait un fraudeur qui aurait une très grosse position, la probabilité, dans une banque autre que la Société Générale – puisque, heureusement, le risque y est désormais encore plus faible compte tenu de ce que nous avons fait – que l’opération coûte aussi cher que chez nous est infinitésimale. Le résultat est la conjonction de la fraude, de l’importance de la position du fraudeur, et du fait que les marchés asiatiques avaient commencé à dégouliner le matin même, dans le sillage de New York et de Paris qui avaient plongé le vendredi midi. Là on n’y peut vraiment rien. Parler en termes de probabilité est horrible puisque nous devrions nous rapprocher du « zéro défaut », j’en conviens. Mais la bonne nouvelle, c’est que la probabilité statistique d’un événement aussi lourd de conséquence est minime. Pourtant, il s’est réalisé. Mais, dans le même temps, les marchés financiers sont tels que nous avons réalisé dans la foulée une augmentation de capital qui a été sursouscrite. Si les marchés avaient cru nos systèmes vérolés et pourris, c’en était terminé. Normalement, 7 % environ du capital sont dans les mains d’actionnaires individuels français. Nous avons donc eu affaire à des investisseurs hyperprofessionnels, que ce soit le fonds de réserve des retraites de Paris ou du Milwaukee. Il a donc fallu leur expliquer pourquoi nous n’avions gagné qu’un milliard, au lieu de cinq. Il n’y a pas que la fraude qui les intéresse, il y a aussi l’économie américaine, l’exposition au risque, et surtout le business plan pour 2010 ; bref, la vision à moyen terme. Et nous avons placé notre augmentation de capital avec un assez grand succès.
M. Louis Giscard d’Estaing : La titrisation permet la dissémination du risque. Pour avoir une meilleure traçabilité, par exemple pour détecter un arrière-goût de subprime dans un produit structuré, ne faudrait-il pas plutôt faire appel à un œnologue qu’à un polytechnicien ?
M. Daniel Bouton : La traçabilité n’est pas parfaite dans la réglementation française, l’INAO 1937 modifié. Non, il n’est pas obligatoire en France, contrairement à la réglementation européenne, de donner la composition par cépage de tout produit au-delà des VDQS. Je suis pour une réglementation qui permette de savoir ce qu’il y a dans un vin. En Bourgogne, c’est du pinot noir à 100 % ; dans le pomerol, vous savez qu’il y a du merlot, du cabernet sauvignon. Quelle était la question au fond ?
M. Michel Bouvard : Qui fait office de CNAOC pour les produits financiers ?
M. Daniel Bouton : Chez un grand producteur, on ne peut pas boire toutes les bouteilles de l’échantillon, mais il y a la marque, le producteur, le négociant. En fait, le contenu du produit figure déjà dans la documentation. Je l’ai regardée de près, puisque nous avons commis l’erreur d’avoir de tels produits. Il est mentionné le pourcentage de tel ou tel subprime, de telle ou telle origine, de telle ou telle qualité.
M. Michel Bouvard : Au premier niveau, mais vous savez bien que des investisseurs se sont retrouvés avec des subprimes pour avoir investi dans des produits d’une telle complexité qu’ils n’étaient plus immédiatement lisibles.
M. Daniel Bouton : Je ne suis pas d’accord. Ces produits ne se vendent jamais aux particuliers, ils ne s’adressent qu’aux super-professionnnels. Mais nous avons été victimes, comme d’autres, du mirage du rating. La documentation juridique existe, tout y est décrit. Mais si les investisseurs professionnels l’ont, les intermédiaires comme les banques, ou les investisseurs finaux ne l’ont pas lue. Ils ont alors découvert qu’un produit triple A pouvait se baser sur des subprimes. Je ne suis pas forcément contre. Il faut que les investisseurs lisent la documentation pour savoir ce qu’ils achètent. C’est fondamental. Cela étant, la mécanique du produit sophistiqué n’est pas morte. Les rapports en cours de rédaction pour les différents régulateurs le disent, il ne faut pas s’arrêter au rating, qui ne vaut que pour ce qu’il donne, à savoir la solvabilité. Il ne mesure pas la liquidité. Il faut aussi que chaque investisseur professionnel fasse son boulot et aille regarder en profondeur.
Le subprime n’est pas mauvais en soi, il a servi pendant trente ans de politique du logement aux États-Unis. Ils n’ont pas d’organismes subventionnés par le contribuable par le biais du monopole d’un produit défiscalisé qui sert à financer le logement social. Ils ont une catégorie de marché qui a permis de loger des millions de ménages désargentés. Ce n’est pas idiot d’autant que, le marché montant, ces ménages ont pu s’enrichir. Néanmoins, pour une raison qui n’est pas très claire à mes yeux, le système a dérapé de 2005 à 2007, dans la mesure où on ne regardait pas si les gens pouvaient payer en ne se référant qu’au ratio loan to value. Ce n’est pas le subprime qui est mort, c’est la queue de distribution de la fin de cycle qui est de très médiocre qualité.
M. Louis Giscard d’Estaing : Concernant la dépréciation et la fair market value, souhaitez-vous une évolution des normes IFRS ? Quelle est votre opinion sur les rehausseurs de crédit ? S’agissant d’un produit bancaire français défiscalisé, que pensez-vous de la banalisation et d’un commissionnement à 0,4 %, comme le recommande M. Camdessus ?
M. Daniel Bouton : Sur ce dernier point, la Fédération représente des intérêts contradictoires puisque la Caisse d’épargne et la Poste en sont membres. Je ne voudrais pas choquer quiconque. Les banques qui proposaient de banaliser le livret A suggéraient 0,80 %. M. Camdessus a écrit 0,40 %. Le rapport Camdessus montrait qu’il n’est plus optimal dans un monde « marchéisé », pour le financement du logement social, de passer par un monopole. Le Parlement et le Gouvernement feront ce qu’ils souhaitent.
La question des rehausseurs de crédit est liée à celles des collectivités locales. Dexia n’est pas seule en cause, il y a aussi les Caisses d’épargne et la Société Générale. Le métier de base des rehausseurs, c’est de permettre à une collectivité locale d’emprunter moins cher que ne le lui permettrait son rating intrinsèque. Une collectivité locale qui a fait des bêtises – aux États-Unis ou en France, c’est pareil – et qui présente une dette par habitant beaucoup trop élevée, paiera sa dette de plus en plus cher, au point parfois de compromettre ses investissements futurs, comme le renouvellement de son réseau d’assainissement. Le système qui existe aux États-Unis, mais, à ma connaissance, pas en France – on pourra y réfléchir – permet à la collectivité, moyennant une prime qu’elle verse à un assureur, de diviser le risque : le risque primaire, celui de la collectivité locale, et le risque contingent, pris en charge par l’assureur « monoline ». Cela permet à la collectivité locale d’emprunter beaucoup moins cher. C’est un métier parfaitement respectable même s’il n’existe pas, en France, pour les collectivités locales. Il vaut mieux que la qualité du risque intrinsèque reste suffisamment bonne, ce qui est le cas aujourd’hui pour l’immense majorité des collectivités locales. Ces dernières années, Calyon, BNP et la Société Générale ont dû passer des provisions car la situation financière de ces compagnies monoline s’est dégradée parce qu’elles vont être appelées en garantie des produits structurés. La bonne nouvelle, c’est que les trois plus grosses d’entre elles ont été recapitalisées : la filiale de Natixis par ses actionnaires, comme la seconde, CIFG, qui a pu conserver son rating, la troisième, Ambac, avec l’intervention d’un syndicat bancaire dans lequel figuraient des banques américaines et BNP-Paribas. La situation n’est pas forcément stabilisée, mais la crise des rehausseurs a franchi un cap.
M. Yves Deniau : Après la réussite de votre augmentation de capital, pensez-vous avoir écarté tout risque d’OPA ? On en a beaucoup parlé, et vous avez d’ailleurs été l’objet d’une tentative il y a neuf ans. À l’époque, vous disiez que 45 % du capital appartenaient à des fonds de pension étrangers et que l’indépendance avait pu être préservée grâce à l’actionnariat salarié, qui représentait alors 9 %. Qu’en est-il de la structure de votre actionnariat aujourd’hui ? Vous garantit-elle l’indépendance en cas d’OPA hostile ?
M. Daniel Bouton : Après une augmentation de capital comme celle-ci, nous faisons une enquête, mais je n’en connais pas encore le résultat qui sera diffusé autour du 15 avril.
Ce n’était pas une véritable tentative d’OPA. La Société Générale présente la particularité d’avoir été l’objet d’une tentative d’OPA rampante en juillet 1988. Vous vous rappelez Marceau Investissement, Georges Pébereau, Marc Viénot, qui avaient occupé l’actualité pendant un moment. Nous avons fait certes l’objet d’une OPA « de marché », comme il en existe normalement en système capitaliste, de la part de la BNP, puis de BNP-Paribas de Michel Pébereau. Nous sommes l’une des rares sociétés au monde à avoir tenu face à une tentative d’OPA rampante, soutenue par un État occidental, et une OPA classique et officielle. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas une troisième. Cela fait partie des règles du jeu. Simplement on connaît, par expérience.
Le Président Didier Migaud : Monsieur le président, madame la directrice générale, je vous remercie.

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
ou la la il faut 1 journee entiere a lire tous ces articles!! 

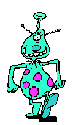
valou- Ecologistes

-

Nombre de messages : 1681
Age : 56
Localisation : beziers
Date d'inscription : 28/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (5/100)
(5/100)
 Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
Re: Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Bouton, président de la Fédération bancaire française
mais s'est pour ce qui ,veul savoir ce qui s'est dit
et qui on pas l'audition

et qui on pas l'audition

avec-amour-et-paix- Journalistes

-

Nombre de messages : 3537
Age : 61
Localisation : montpellier
Humeur : belle
tendances politiques : anarchiste
Date d'inscription : 18/02/2008
Niveau de Courtoisie:
Gérer par le Tribunal:


 (14/14)
(14/14)
Argent de poche:


 (0/100)
(0/100)
 Sujets similaires
Sujets similaires» Lettre ouverte au Président de la République française
» Lettre ouverte au président Sarkozy
» Fritch président de l’assemblée de Polynésie française
» Gaston Flosse élu Président de la Polynésie française
» Le "pPays" de "la Polynésie française" (sic) déteindrait-il sur le président du conseil d'Etat hors de ses murs...
» Lettre ouverte au président Sarkozy
» Fritch président de l’assemblée de Polynésie française
» Gaston Flosse élu Président de la Polynésie française
» Le "pPays" de "la Polynésie française" (sic) déteindrait-il sur le président du conseil d'Etat hors de ses murs...
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum